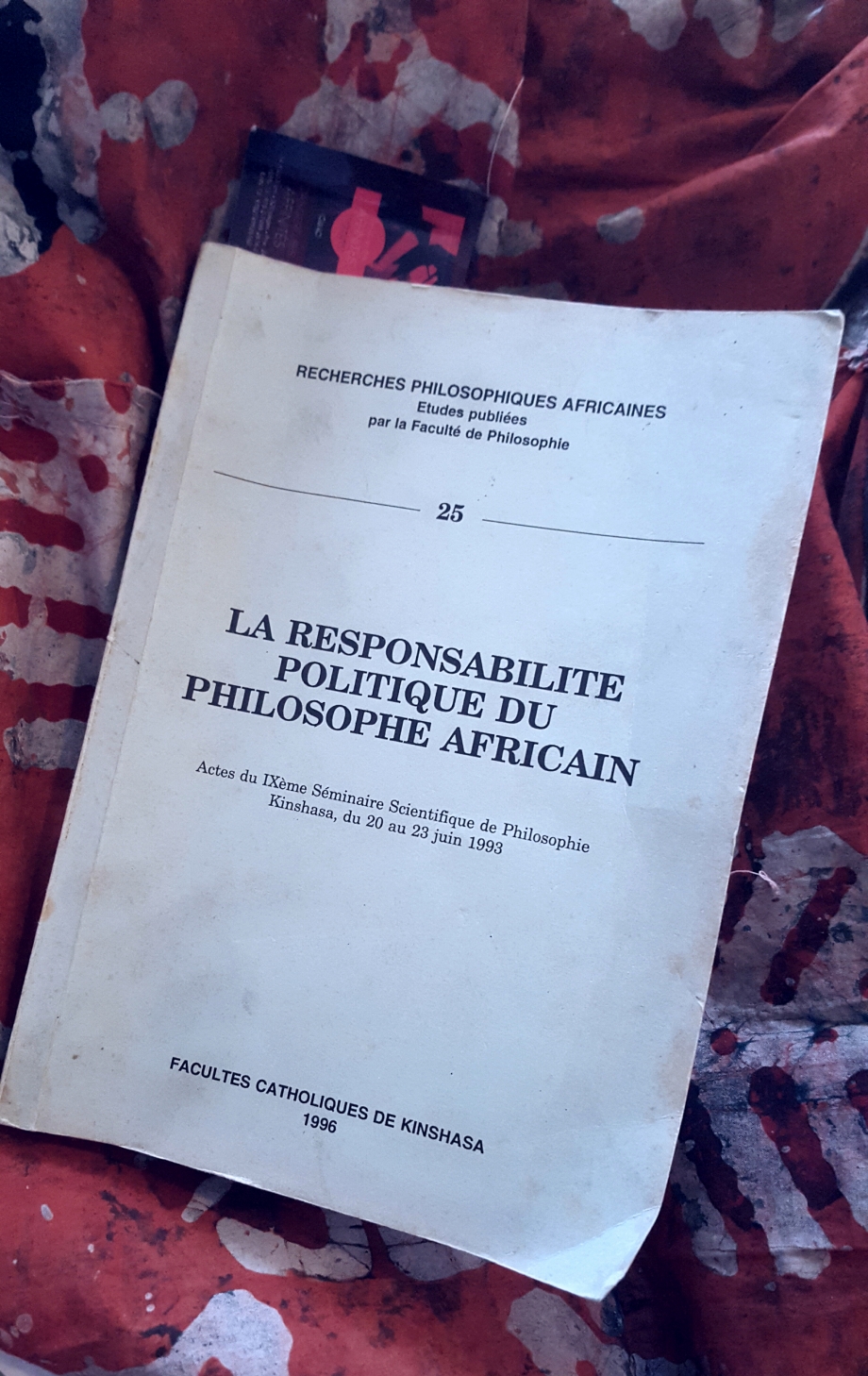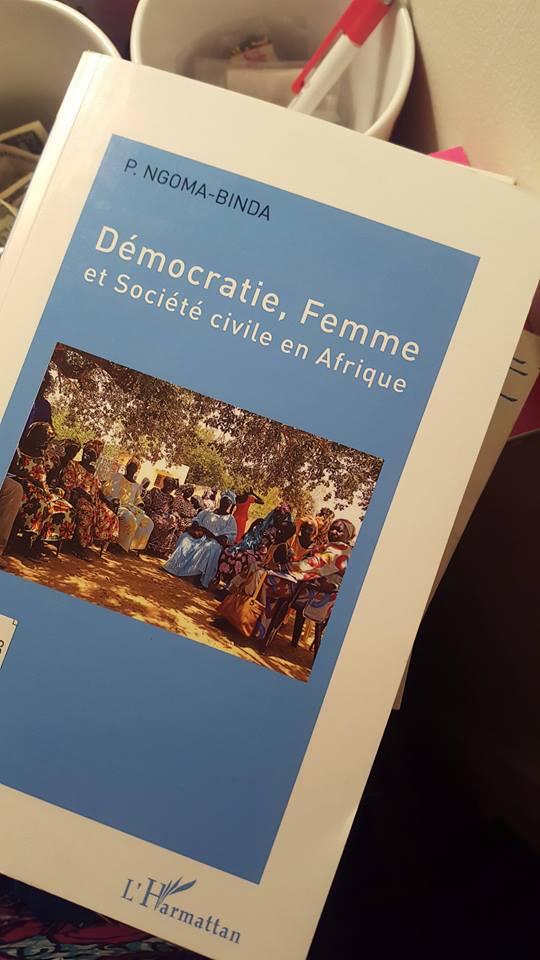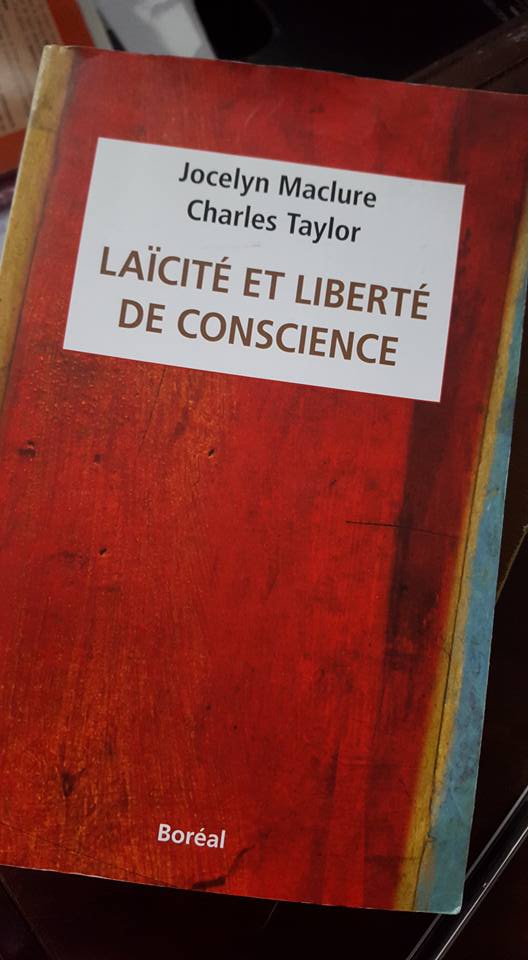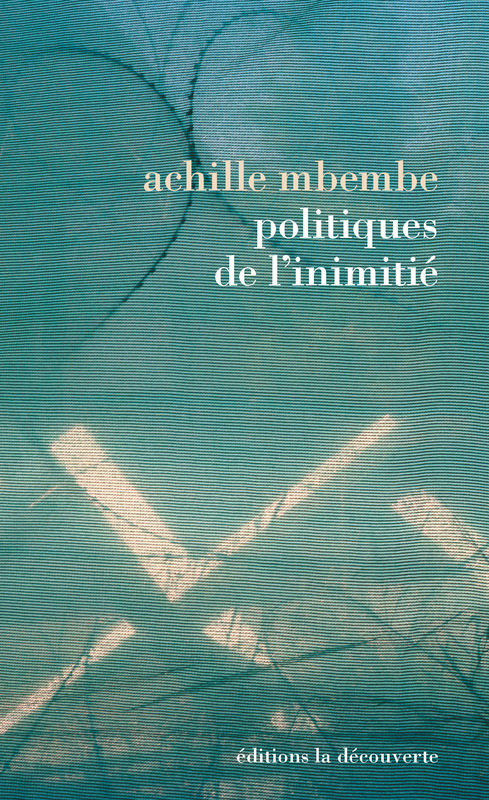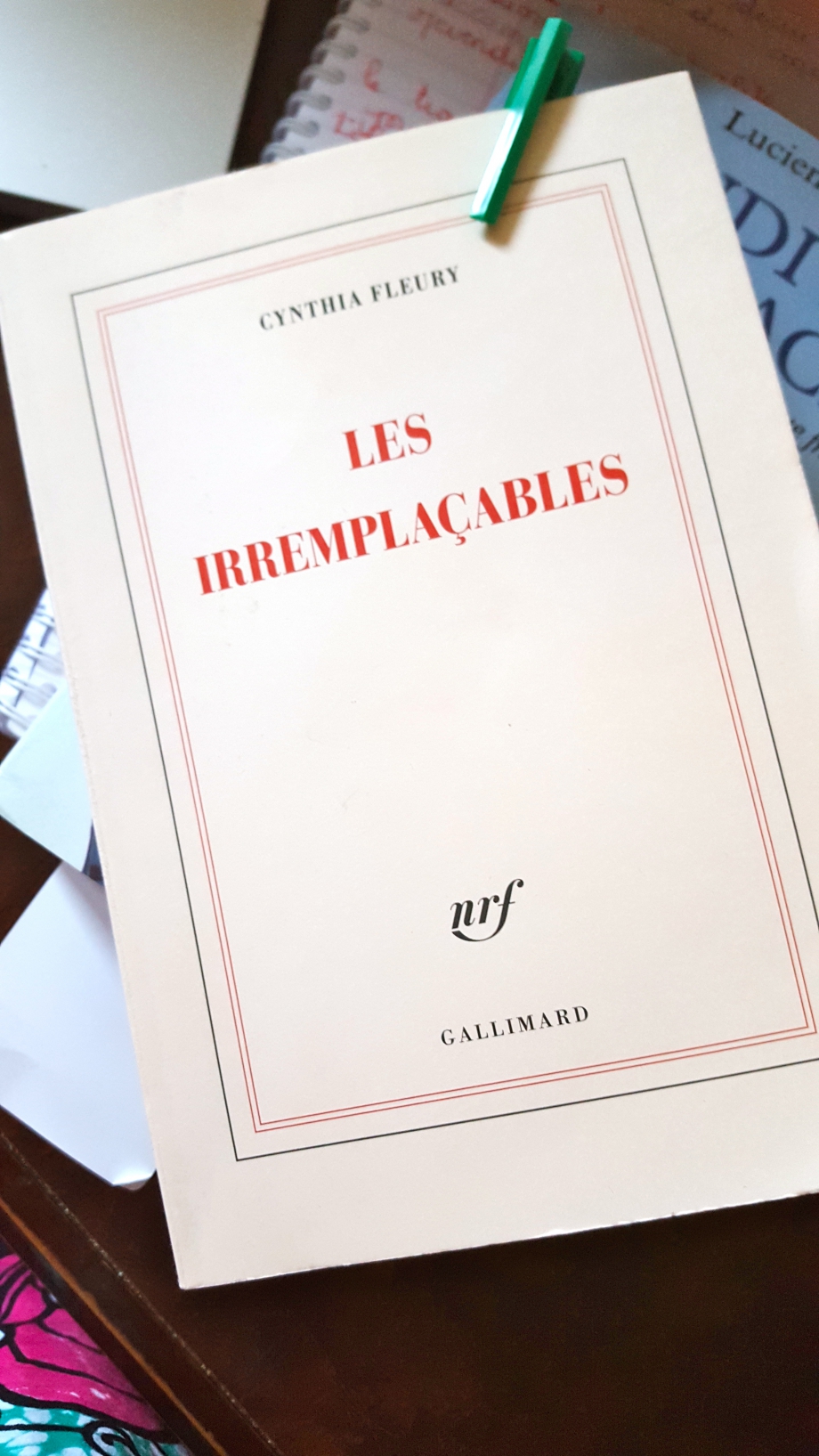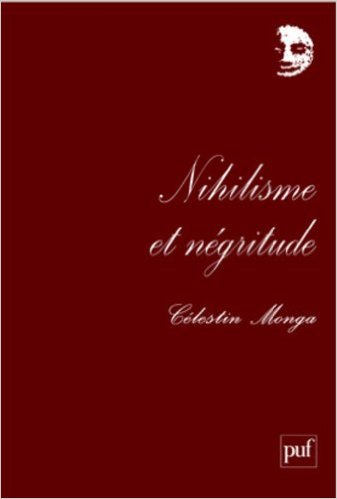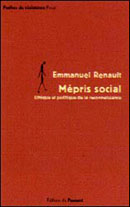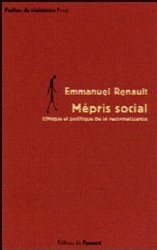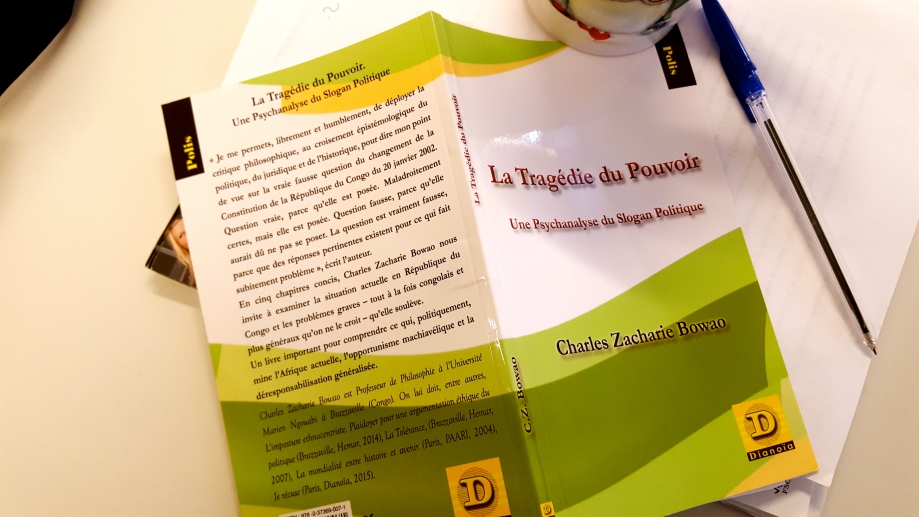Recensions d'ouvrages Philosophiques
La République des philosophes ou le paradoxe d'un engagement, Okolo Okonda
Dans cet article, Okolo Okonda s’inspire de l’histoire de la philosophie pour penser l'engagement des philosophes d'aujourd'hui sur les problèmes de notre époque. Pour cela, il a ciblé quelques philosophes bien connus: Parménide, Héraclite, Platon, Aristote, Kant, Marx, Heidegger. L’article, à partir de cinq points précis, répond à la question suivante : La République des philosophes est-elle possible ?
Un désengagement engagé
Dès son apparition, la philosophie est politique. Elle est marquée par lplusieurs manifestations. Ce sont des manifestations qui se soldent par l’arrestation de quelques leaders qui subissent des persécutions de la part du gouvernement. Certains philosophes ont, par ailleurs, connu l’exil. Parmi les philosophes qui entretenaient la fibre politique, Okolo Okonda cite Héraclite dont « la pensée et les attitudes sont révélatrices de la nature paradoxale de l’engagement politique du philosophe » (15). Dans le Fragment 121, le philosophe d’Éphèse scande : « Que personne parmi nous ne soit le meilleur ! Sinon qu’il s’en aille ailleurs et avec d’autres hommes ». En réalité, c’est une manière pour l’auteur de traduire sa déception. Dans le Fragment 9, il écrit : « Les ânes préfèrent la paille à l’or ».
Un clin d’œil sur Parménide nous signifie qu’il a été Législateur et homme politique reconnu. Cependant il est resté neutre et n'a pas pris de position claire envers la chose publique.
Au sujet d’Héraclite, Diogène Laërce (IX, 3) rapporte qu’il (Héraclite) jouait avec des enfants dans la cour du temple d’Artémis, lorsque vinrent auprès de lui quelques éphésiens tout étonnés de le trouver là. Il leur dit : « De quoi vous étonnez-vous ? N’est-il pas mieux de faire ce que je fais que d’être avec vous en train de vous occuper des choses de la cité » ?
De cette anecdote, on pourrait définir le désengagement désengagé comme le refus de participer à une politique politicienne dans le but de s’axer sur l’objet de la vraie politique. Héraclite ne rejette pas le gouvernement éphésien de son temps, mais il s’engage autrement. Pour mieux comprendre cette forme d’engagement, il est important de comprendre le cours d'Heidegger sur Héraclite. Selon Heidegger, trois termes forment le socle de la pensée d’Héraclite : Le feu, le jeu et dieu.
Le feu, c’est ce qui est à l’origine de tout, qui embrase tout, qui consume tout. Il est dieu ou Logos et son activité n’a pas de finalité car c’est un éternel jeu. Selon Okolo Okonda, « le mot d’Héraclite veut rappeler aux Éphésiens que la politique n’est pas l’activité la meilleure ni la plus élevée. La plus élevée en dignité n’est pas toujours celle que l’on pense. Le jeu d’un enfant est plus élevé parce que plus conforme à l’être que ne l’est la politique des Éphésiens » (p. 16).
On peut dès lors comprendre que dans la mesure où l’être est feu, jouer avec l’enfant (activité conforme à l’être), c’est reproduire les gestes de l’être. Par conséquent, Héraclite remet la politique à sa place en lui permettant de comprendre qu’elle n’est pas au-dessus de la piété, du Logos et du jeu. Il montre que c’est le Logos qui oriente la politique, l’éclaire et la guide. En jouant avec l’enfant, Héraclite enseigne aux Éphésiens que la politique est un jeu et ses solutions sont en deçà de la recherche des solutions du jeu des enfants. Ce qui est tout à fait réel, car si l’on observe les problèmes qui se posent aux politiques, on se rendra compte que ce sont des questions qui sont techniques et facilement résolvables. C’est le cas pour l’éducation ou encore la construction des hôpitaux. Ce qui n’est pas le cas pour le jeu de l’enfant qui demande une grande concentration.
En somme, Héraclite se désengage de la politique politicienne, mais demeure engagé dans la vraie politique, car en jouant avec l’enfant, il participe de la construction de l cité.
Un engagement désengagé
Suite à la mort de Socrate, Platon et Aristote ramènent la politique dans la philosophie afin que les philosophes ne sombrent pas dans le politicisme. Ils instaurent « une République des philosophes, une Cité où le philosophe serait roi, une cité régie par des princes philosophes ».
Platon est un philosophe de l’engagement. Cette idée traverse l’ensemble de son œuvre et plus particulièrement « République ». Fondateur de l’Académie, son objectif est de former les futurs dirigeants des cités grecques. Mais de quoi est fait l’engagement politique de Platon ? D’une moralité, comme le montre « République ». Il montre que conduire une Cité est un devoir et non un canal d’enrichissement ou de recherche de visibilité. C’est pourquoi lorsqu’un philosophe s’engage pour la politique, son devoir c’est de ne pas laisser le pouvoir entre des mains immorales et déshonorables.
Notons tout de même que Platon reste un engagé très prudent. Il invite à s’abstenir lorsque les conditions ne sont pas réunies. Il conseille de camper dans les limites du possible : « Il faut éviter l’héroïsme gratuit, des crimes inutiles contre la philosophie » (République IV, 496-497a)
Quant à Aristote, il ne cherche pas à devenir conseiller d’un homme politique. Ce qui l’intéresse c’est l’éducation et la réflexion, parce qu’il sait que c’est en enseignant que l’on fait des hommes et des citoyens. Il fait partie des philosophes qui partent en exil afin d’éviter aux Athéniens un nouveau crime contre la philosophie. Son objectif est d’aider la société à se conformer à un type de société idéal ; idéal qui se trouve dans le choix de régime que l’on opère. Aristote demeure conscient qu’il n’existe pas de meilleur régime. Par ailleurs, il insiste sur l’idée que, peu importe le type de régime qu’on aura choisi, ce qui compte c’est la garantie de la justice, de l’esprit de logique et de la médiété. En somme, Aristote est pour le réalisme politique.
Conflit : raison-liberté
L’auteur analyse ici le texte de Kant : Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ». Pour Kant, l’Aufklärung constitue la sortie de l’homme de son état d’adolescence pour le conduire vers l’état d’adulte où il est libre et responsable. Il souligne l’importance de la sphère publique dans l’engagement de l’homme, car c’est à travers l’utilisation publique de sa raison qu’il peut exercer sa liberté et la tolérance. Pour Okolo Okonda, « la leçon à tirer des modernes c’est que l’engagement politique ne se sépare pas d’un engagement philosophique profond. « Audere sapere » : Osez savoir et cela ne peut aller que dans la liberté, écrivait Kant. » (19)
Dictature ou démocratie
Avec Karl Marx, Savoir et penser ne suffisent plus à manifester un engagement politique. l’auteur de Le Capital affirme que la politique est un tissu d’intérêts que la pensée ne peut suffire à traduire. Elle est faite de rapports de domination. C’est pourquoi, « L’engagement politique précède toute pensée susceptible de participer à la libération de l’homme » (19). En accordant la primauté à la pratique, il finit par considérer théoriquement la philosophie comme la lutte des classes. L’inconvénient de la théorie des Marx c’est qu’en donnant le pouvoir philosophique à chaque chef d’État, elle les aide à installer la tyrannie, car les libertés fondamentales prennent un coup. C’est le cas de beaucoup de présidents africains qui se sont pris, illusoirement, pour des rois-philosophes. le grand problème c'esy qu'ils ne sont pas parvenus à intégrer le paradoxe raison-liberté.
Engagement controversé.
Martin Heidegger s’est trouvé du côté des Nazis dans les années 30. Le monde le lui a reproché. Il s’en est expliqué dans une interview qui a été rendu public après sa mort. Il justifie son engagement et plus tard son désengagement. Pour Okondo Okola, la pensée d’Heidegger, bien au-delà de toute stigmatisation, demeure politique, à l’instar de celle de Platon, Aristote ou Kant. Son engagement politique vient de sa vision de l’humain. Et l’on sait qu’à un moment, certains engagements en faveur de l’humanité ou d’une nation peuvent virer au nationalisme ou au patriotisme illuminé. Il estime, de ce fait, qu’on ne peut pas reprocher à Heidegger son germanisme duquel ne pouvait a postériori découler le racisme, l’antisémitisme ou le totalitarisme.
Conclusion
Pour Okondo Okala la République des Philosophes est de l’ordre de l’illusion, car la philosophie elle-même s’y oppose. De fait, elle va à l’encontre de l’exercice de la liberté de même qu’à l’idée de la politique comme jeu d’intérêts. Pourtant, dans son être au monde, le philosophe sait quel est son rôle : être la conscience du monde. À ce propos, il écrit :
« L’engagement politique du philosophe c’est d’abord un engagement de tout homme, de tout citoyen. Avec les autres et plus que les autres, il porte à cœur la chose publique. Mais en tant que philosophe, son engagement passe par une pensée profonde et correcte. L’engagement politique est controversé s’il édulcore la philosophie. Le philosophe c’est un homme d’une pièce. On ne lui pardonne jamais l’incohérence et l’inconséquence, théorique ou pratique. Le philosophe doit tendre vers la sagesse, c’est-à-dire vers une plénitude d’action qui fait suite à une plénitude du savoir. Enfin, l’engagement du philosophe se traduit par un discernement dans les causes à défendre. Ici le peuple et l’histoire ne lui pardonnent pas l’erreur. C’est là une conséquence de l’interaction nécessaire entre pensée et action. Logique, conséquence et justesse de vue, voilà ce qui caractérise l’engagement du philosophe, voilà la mesure de sa responsabilité » (p. 22)
Par l'Équipe du Blog de Philosophie Politique.
Références
Okolo Okonda, La République des Philosophes in "Recherches philosophiques africaines", Kinshasa, FCK,p. 15-22, N°25, 1993.
Qui est Okolo Okonda?
Benoît Okolo Okonda est né en 1947 à Lodja, en République démocratique du Congo.
Après les études de philosophie, de théologie et de langues et littératures africaines, il est docteur en philosophie (Université de Lubumbashi) et actuellement professeur de philosophie à la Faculté catholique de Kinshasa, à l’université de Kinshasa et à l'université Saint Augustin de Kinshasa. Après son doctorat en philosophie, il se rend à Heidelberg (Allemagne) pour approfondir ses recherches en philosophie, où il rencontre Hans-Georg Gadamer. Okolo est surtout reconnu comme un important théoricien de l'herméneutique et de la tradition africaine.
LOKENGO ANTSHUKA NGONGA: Consensus politique et gestion démocratique du pouvoir politique en Afrique
Voici un livre qui participe aux débats sur la philosophie politique en Afrique. Après avoir mené le lecteur dans les origines du mot « démocratie » en son versant athénien et moderne, l’auteur précise sa conception du consensus.
Le livre est intéressant en ce qu’il nous renvoie à l’expérience démocratique dans l’Afrique traditionnelle. Lokengo Antshuka Ngonga, politologue congolais, clarifie son approche en évoquant les cas des Nkole et des Igbo. Il poursuit son approfondissement de cet apport contextuel en dégageant les « caractéristiques des démocraties africaines anciennes » (p. 165). Il énumère par conséquent : un « système communautaire non partisan », un « système plural et ouvert à tous », un « système à caractère social et politique », un « système consensuel ordonné », un « système garantissant la relève de l’autorité », un « système basé sur la coexistence pacifique », un « système prônant l’équilibre institutionnel », et enfin, « un système fondé sur le respect de l’être humain ». De tels processus contribueraient volontiers à la réinvention des pratiques démocratiques contemporaines.
C’est en ce sens qu’il nous est proposé quelques conditions pour sortir l’Afrique politique de ses écueils à la démocratie. L’approche qui les contrebalance en appelle à plusieurs facteurs dont, une formation des citoyens afin de se structurer sur le projet de la démocratie. A cet égard, une restructuration des forces de sécurité et de l’armée est nécessaire. Pourra-t-on détribaliser l’armée et la rendre à son premier objectif de protection du territoire et non la mettre au service d’un potentat ? En tout cas, pour l’auteur, « détribaliser les forces de sécurité en général et l’armée en particulier est une exigence patriotique » (p. 204) ; Un éveil démocratique nécessite de « restituer à la femme africaine sa place dans la cité » (p. 205). Cette perspective est de la plus haute importance car, « en Afrique, la femme est la gardienne de la culture, la conservatrice des valeurs ancestrales » (p. 205). La démocratie pour l’auteur fait donc de la femme « l’égale de l’homme à tout point de vue ». L’engagement de la femme en démocratie lui permettra d’œuvrer à la réalisation du projet démocratique construit autour de la liberté, de la justice, et de l’égalité. Les femmes comme les autres citoyens doivent être formés à cet égard.
Peut-on fonder la démocratie sur le consensus ?
Akono François-Xavier.
Références:
LOKENGO ANTSHUKA NGONGA, Consensus politique et gestion démocratique du pouvoir politique en Afrique, Louvain-la-Neuve, L’Harmattan, Academia, 2015
Démocratie, Femme et Société civile en Afrique de Ngoma-Binda
Tirant des leçons de la manifestation des démocraties africaines à l’heure actuelle, l’ouvrage du philosophe Ngoma-Binda, qui adopte une méthode réflexive et sociologique, a un seul objectif : l’avènement de la démocratie en Afrique doit devenir meilleure et adéquate. Et pour cela il faut l’apport de deux réalités jusque-là mises de côté. Les femmes et la société civile. Pour comprendre cela nous n’avons pas besoin de lire des tomes et des tomes d’ouvrages de philosophie et de science politique. Le problème est là : le mal en Afrique est issu de l’inertie de sa société civile. Écrit en 2012, ce livre reste encore d’actualité au moment où certains pays d’Afrique ont du mal à décoller démocratiquement, car si l’avènement démocratique du début des années 90, à partir de l’autodestruction des idéologies communistes en 1989, a conduit toutes les cultures monopartites africaines à la démocratie, il faut reconnaître aujourd’hui que cela a davantage été un effet de mode qu’une démocratie dont l’essence se situe dans la souveraineté du peuple, la liberté et l’égalité. Ngoma-Binda rappelle donc que la démocratie avant d’être un régime politique doit d’abord être une mentalité, mais les peuples d’Afrique ont-ils été préparés à la démocratie ?
Démocratie dans l’Afrique post Coloniale : ce qu’il faut pour l’avènement d’une démocratie libérale.
Pour Ngoma-Binda, la démocratie imposée des années 90 est une « médication forcée » que les dirigeants africains acceptent à contrecœur. Dès lors les nouveaux démocrates usent de tous les moyens pour contourner les principes démocratiques. Il existe certes le multipartisme, mais la logique du pouvoir reste celle d’u monopartisme où sont bâillonnés ceux qui osent élever leur voix pour contester la corruption de la démocratie. Certains partis qui se disent d’ailleurs de l’opposition ne sont, en fait, que le reflet de ce monopartisme qui s’enlise dans l’ethnocratisme téméraire et dans le clanisme absolu. De ce fait, il paraît impérieux de mettre en place les conditions de possibilité et de survie d’une démocratie.
Premièrement le philosophe suggère la possibilité de revoir la « logique d’accession » au pouvoir politique en Afrique. Pointant du doigt la manière dont sont arrivés les hommes au pouvoir au moment de l’indépendance, l’auteur estime que c’est de là que tout est parti. Désormais, démocratie ou pas, les États africains se complaisent dans des coups d’états ou encore dans des assassinats pour pouvoir arriver au pouvoir. Peu importe alors la volonté du peuple. De ces accessions au pouvoir rudimentaires on note l’instauration des partis uniques. Ce qui malheureusement, selon Ngoma-Binda, n’a pas changé, car la stratégie politique est encore la même, formatée dans les cerveaux de plusieurs chefs d’États africains qui, désormais n’hésitent pas à parler de démocratie africaine pour justifier leur folie du pouvoir. Par exemple, l’auteur écrit que « pour l’ensemble des cinquante ans des indépendances africaines, on aura connu 45 coups d’État militaires (de 1960 à 1980) plus 59 coups, soit exactement 104 coups et assassinats, et pas moins de deux centaines de tentatives de coup d’État violents » (p. 35).
Deuxièmement l’auteur évoque la non-alternance comme une volonté d’éternisation au pourvoir. Si dans la logique démocratique la logique et le principe de l’alternance sont mis de l’avant, dans la logique des démocraties africaines, « on ne connaît que très peu la notion d’alternance quand bien même on clame évoluer dans un système démocratique. Il en résulte que la volonté d’éternité au pouvoir constitue une source des misères politiques et de la mauvaise gouvernance de l’Afrique. Dès qu’ils ont accédé au pouvoir, mourir au pouvoir devient immédiatement le plus grand idéal des chefs d’État D’Afrique ». (p. 40). Ainsi donc les stratégies, selon Ngoma-Binda, utilisé pour s’éterniser au pouvoir sont : la fraude électorale, la contorsion de la constitution nationale et le dauphinage génétique. À cela s’ajoute les trois arguments pour justifier ce désir d’éternité au pouvoir : le travail entamé ne peut jamais s’arrêter, le président se considère comme étant seul garant du bonheur du peuple et la tradition africaine qui peut faire de lui un chef à vie.
La femme au pouvoir : engendrement de la politique
L’auteur dénonce ici la confiscation de l’espace politique par la gent masculine. Il s’interroge : « Une démocratie politique est-elle possible sans la participation de la femme ? Rigoureusement masculinisée, la politique ne manque-t-elle pas de civilité, et d’efficacité parce que, précisément, elle exclut la féminité ? Mais est-il vraiment justifié de souhaiter l’arrivée des femmes dans la démocratie des hommes ? » (p.59)
Pour l’auteur, une démocratie où la femme est prise à la légère est une démocratie inachevée. C’est pourquoi il dénonce la misogynie rationnalisée ou l’incompétence de la femme dans l’espace publique. Selon lui si le rejet de la femme est visible dans toutes les sociétés, en Afrique, elle est pire car la tendance générale considère que la sphère publique ne porte que l’émanation de l’homme. La femme est moquée, dédaignée et des fois réduite à un instrument à la solde du pouvoir. Corruption et frivolité semblent la caractériser ou, du moins, c’est tel que les hommes la voient. À côté de ses jets dont est victime la femme, il y a aussi la femme elle-même, ou plutôt la tradition qui a fait de la femme un humain de seconde zone culturelle en ne lui donnant pas accès à l’éducation de manière équitable avec l’homme. L’idée qui consistait à réduire la femme dans la sphère du mariage a fait plus de dégâts que l’on ne peut imaginer car le phallocratisme fait de la femme un éternel enfant pour qui l’homme demeure le seul garant de tout ce qui doit se faire.
En somme ce qu’il faut retenir ici c’est que pour NGoma-Binda, la justice demeure au fondement de la participation politique de la femme. Il invite, de ce fait, les femmes à prendre conscience : « Femmes, recherchez tout d’abord le royaume élevé de l’éducation, de la qualification, et en toute légitimité, la parité vous sera donnée naturellement. Recherchez la parité raisonnée et raisonnable, non turbulente, non téméraire, et non absolument « zébrée », et l’harmonie régnera, dans nos foyers et dans nos nations » (p. 103-104)
L’engendrement d’une société civile politique
Pour Ngoma Binda, l’apolitisme et l’indépendance sont les deux principes de jugements et d’action de la société civile. Dans ce sens la société civile ne vise aucun accès à un gouvernement quelconque et ne vise aucun poste politique. Elle se proclame de la neutralité et de l’impartialité. Le risque que court les différentes sociétés civiles africaines c’est celui de la corruption politique et mentale. Il est à noter, de nos jours que plusieurs hommes de pouvoir ont à cœur de financer des associations de la société civile en vue de les arrimer à leurs arcs lors d’élections ou encore de mouvement de soutien comme le référendum pour le changement de la Loi fondamentale nationale. Cependant tout en étant apolitique, la société civile demeure le lieu de l’éducation de la citoyenneté. En gros, elle a pour mission de former le citoyen à la politique sans se politiser elle-même, même si, sur une entente avec ses membres et devant une situation d’extrême urgence, elle peut décider d’entrer en politique. En somme pour Ngoma-Binda pour qu’elle tienne, si elle veut entrer en politique« la société civile (…) est tenue d’actionner des règles de transparence et de démocratie en son sein, dans sa structuration et dans son fonctionnement » 128
Citoyenneté mature et bon exercice du pouvoir
L’auteur déplore ici le manque d’innovation et d’adaptation de la part des démocraties africaines, pour repenser cette démocratie libérale pour laquelle ils ont tous optés. La quasi-totalité des constitutions africaines affirment des principes qui n’ont aucun ancrage dans la réalité. Ils sont, au contraire bafoués. En bref, il s’agit d’un copier-coller des constitutions occidentales en mal d’adaptation. On ne peut pas parler de démocratie en Afrique lorsqu’on est incapable de respecter les Constitutions nationales. Pour l’exercice d’un pouvoir politique démocratique viable, Ngoma-Binda évoque quatre idées. Primo une vision claire, éclairée et pertinente. Secundo le sens de justice impartiale. Tertio un courage soutenu par une détermination sans faille. Quarto une volonté ferme nourrie à de l’énergie spirituelle inébranlable pour la cause de la nation et de l’humanité en elle. (p. 153).
Au-delà de quelques limites sur la place et le rôle de la femme dans les démocraties, l’ouvrage de Ngoma-Binda propose une réflexion socio-politique et philosophique nouvelle sur les questions de la démocratie libérale en Afrique. Il pose par-delà le traditionalisme africain le lien entre le particulier et l’universel concret, car il n’est pas possible de parler de démocratie, qu’elle se vive en Afrique ou ailleurs, lorsque les fondements de la démocratie sont mis à l’écart de la politique. Son approche sur la gestion de la société civile est d’une pertinence indéniable car, si aujourd’hui la démocratie a du mal à décoller en Afrique c’est bien parce que la société civile elle-même peine à se définir dans les sphères qui sont les siennes, se laissant embrigader par le pouvoir politique où lorsqu’elle n’est pas considérée comme une société civile, elle est considérée comme l’ensemble des micros partis avec comme vocation de servir le pouvoir corrompu « en voie de métamorphoses vers des formes insidieuses de monarchies ou de principautés » (p. 155). L’approche sociologique a été utile parce qu’elle a permis de se rendre compte que la question démocratique pose vraiment des questions quant au développement économique et culturel du Continent, car la quasi-totalité des États africains ont un problème avec les principes démocratiques. L’auteur est parti d’une enquête sociologique qui lui a servi de point d’ancrage. Quatre leçons se dégagent donc de ce livre. La première c’est de repenser la démocratie libérale à l’universel en augmentant ses prescriptions. La deuxième est celle d’accepter la pleine intégration de la femme et de la société civile dans la gouvernance politique. La troisième est la reconduction satisfaite du libéralisme et l’invention d’une forme libérale alliée au communautarisme. La quatrième c’est de privilégier la relation à autrui en investissant de la sincérité et de la responsabilité dans la reconnaissance intelligente de l’autre. Le tout dans une volonté de « civilisation de la démocratie » qui commence d’abord dans la « civilisation » de la politique.
Pénélope Mavoungou
P. Ngoma-Binda, Démocratie, Femme et Société civile en Afrique, Paris, Éditions L’Harmattan, 2012 ;
Biographie :
Ngoma-Binda est professeur de philosophie, de science politique et d’éthique des affaires à l’Université de Kinshasa, directeur de l’Institut de formation et d’études politiques (Ifep). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de philosophie, de science politique et de littérature.
Laïcité et liberté de conscience: Jocelyn Maclure et Charles Taylor
Laïcité et Liberté de Conscience de Jocelyn Maclure et de Charles Taylor a été publié pour la première fois en 2010. Il est issu de la participation des deux philosophes québécois à la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles au Québec dont ils ont été les rédacteurs du Chapitre 7. L’une des principales particularités du livre c’est qu’il s’ancre dans la réalité de terrain à travers l’exemple de la laïcité dans son expression québécoise plus notamment. Cet ancrage constitue donc à la fois la simplicité et la rigueur de l’ouvrage car il dépasse les simples conclusions du rapport pour embarquer le lecteur dans une dimension à la fois historique, philosophique, juridique et sociétale. Dès l’introduction les auteurs n’hésitent pas à soulever le caractère complexe du mot Laïcité : « (…) La laïcité est complexe, car elle est faite d’un ensemble de finalités et d’arrangement institutionnels » (p. 11). En outre, chez eux la question de la Laïcité ne peut se limiter à des questions de religion. Elle est plus large.
Le livre comprend deux parties et onze chapitres.
Ce qu’il faut savoir sur la Laïcité
La Laïcité, nous rappellent les auteurs, est une question de neutralité qui ne privilégie aucune religion. Pour qu’elle ne tourne pas en un privilège il faut de la part de l’État qui se dit Laïque des pré-requis comme l’impartialité. En mettant face à face la neutralité de l’État et la question du pluralisme moral, l’objectif est de faire comprendre que dans la mesure où c’est l’égal respect et la liberté qui président dans une société démocratique, les différentes visions du monde qu’elles soient de l’ordre de la foi, de la tradition ou de la morale ne doivent jamais influencer la décision et le rôle de l’État. Seulement cela ne signifie pas que l’État doit les occulter, car « la question de la Laïcité doit (…) être abordée dans le cadre de la problématique plus large de la nécessaire neutralité de l’État par rapport aux multiples valeurs, croyances et plans de vie des citoyens dans les sociétés modernes ». (p. 19). L’État est souverain et ne doit prendre position sur aucune valeur parce que son rôle est de transcender toute croyance pour privilégier le dialogue démocratique. De ce fait, devant le pluralisme des groupes ou des individus, seule la neutralité de l’État peut favoriser le vivre-ensemble et permettre la participation de tous dans la sphère publique.
Qu’est-ce que la Laïcité ?
« La laïcité est l’une des modalités du régime de gouvernance permettant aux États démocratiques et libéraux d’accorder un respect égal à des individus ayant des visions du monde et des schèmes de valeurs différents » (p. 29). Selon Maclure et Taylor, la Laïcité repose sur deux grands principes à savoir, l’égalité de respect et la liberté de conscience. Deux modes opératoires permettent de réaliser ces principes. Premièrement la séparation de l’Église et de l’État ; deuxièmement la neutralité de l’État. Ils insistent par ailleurs que ces modes opératoires sont indispensables pour la réalisation de la Laïcité. Le premier principe est un guide pour l’attitude de l’État Laïque. Il lui permet de se placer au-dessus des particularismes pour dire le droit, la démocratie et la dignité humaine.
Les régimes de la Laïcité
Pour déterminer un régime de la Laïcité, les auteurs estiment qu’il faut tenir compte de leur connexion avec la « pratique religieuse ». De ce fait la laïcité peut être radicale ou non, « rigide », « sévère » ou non ; « souple », « ouverte » ou non. Cela dépend de la manière dont elle se comporte devant une situation donnée (par exemple la visibilité d’un signe religieux dans certains lieux par exemple). Partant, il existerait donc deux régimes de la Laïcité : le régime républicain et le régime libéral pluraliste.
Le premier « attribue à la laïcité la mission de favoriser, en plus du respect de l'égalité morale et de la liberté de conscience, l'émancipation des individus et l'essor d'une identité civique commune, ce qui exige une mise à distance des appartenances religieuses et leur refoulement dans la sphère privée » (p. 46). Il se focalise prioritairement sur les modes opératoires qui deviennent non plus seulement des moyens mais des valeurs à savoir la neutralité et la séparation de l’Église et de l’État. C’est le cas de la Laïcité dans sa formule française. Ce qui est mis en avant ici c’est la relation de la religion avec l’espace public et l’espace privé, car la religion y est invitée à garder sa place dans la sphère privée.
Le second (libéral pluraliste) « voit quant à lui la laïcité comme un mode de gouvernance dont la fonction est de trouver l'équilibre optimal entre le respect de l'égalité morale et celui de la liberté de conscience des personnes » (Ibid.). Ici ce qui est fondamental ce sont les principes de l’égal respect et de liberté de conscience. C’est le cas de la Laïcité dans sa formule québécoise qui ne focalise pas son discours sur la présence ou non du religieux dans l’espace public, mais qui visant l’équité et le respect de la liberté des consciences va avoir recours aux « accommodements raisonnables pour régler un contentieux ».
In fine, ce régime de laïcité vise « la conciliation optimale de l’égalité de respect et de la liberté de conscience » (p. 37)
Le public et le privé
La thématique du public et du privé est au cœur de la question de la Laïcité dans les sociétés démocratiques. C’est un couteau à double tranchant parce que si elle est le lieu du problème, elle est aussi le lieu de la solution. C’est comme l’écrit Pierre Manent, « le lieu stratégique où se nouent leurs difficultés, leurs drames et aussi leurs possibilités (…) », (Manent, p. 69). Après avoir donné le sens de « Public » selon l’Antiquité et selon le siècle des Lumières, les deux auteurs du livre démontrent que le problème de la Laïcité avec l’espace public viendrait peut-être de ce double sens où finalement le problème de la neutralité peut être vu sous deux angles où l’on choisirait soit de tolérer le signe religieux dans l’espace public, soit d’en interdire l’ostentation.
Somme toute les auteurs reconnaissent le caractère général et donc imprécis de cette distinction public-privé pour pouvoir « évaluer la place de la religion dans l’espace public » (p. 54), car là où existe véritablement la liberté d’expression, chercher à limiter la religion dans l’espace privé relèverait soit de l’utopie soit de la dictature mentale.
La question des accommodements raisonnables
Commençons par nous souvenir que la liberté de conscience avec l’égal respect fait partie des principes de la Laïcité. Dans la deuxième partie qui se focalise précisément sur la liberté de conscience, les auteurs reconsidèrent avec soin le deuxième régime de la Laïcité qui est la Laïcité pluraliste en partant du modèle québécois. Après un bref rappel de la liberté de religion qui est inscrit dans les documents juridiques nationaux et internationaux, les auteurs soulignent que la « liberté de religion inclus la liberté de pratiquer la religion » (p. 83). Pourtant il n’est écrit nulle part que cette liberté permet les accommodements des différentes situations. Se pose ainsi la question de ce qu’il faut accommoder, mais surtout celle de savoir pourquoi faut-il accommoder les croyances alors que les personnes, avec handicap physique ou mental, par exemple vivent leur handicap comme si de rien n’était. Selon Jocelyn Maclure et Charles Taylor les accommodements raisonnables reposent sur deux grandes prémisses qui justifient leur pertinence : « 1) les règles qui font l'objet de demandes d'accommodement sont parfois indirectement discriminatoires à l'endroit des membres de certains groupes religieux ; 2) les convictions de conscience, qui incluent les croyances religieuses, forment un type de croyances ou de préférences subjectives particulier qui appelle une protection juridique spéciale » (p. 93). Ces deux règles réunies permettent de comprendre que dans l’adoption d’un accommodement raisonnable ce qui compte ce n’est pas d’adapter chacune des situations, mais plutôt celles qui sont nécessaires à la construction sociale et qui n’empiètent pas l’idéal des démocraties c’est- dire celles qui permettent de « donner un sens et une direction » (p.97) à la vie d’un citoyen et « permettent de structurer son identité morale et d'exercer sa faculté de juger dans un monde où les valeurs et les plans de vie potentiels sont multiples et entrent souvent en concurrence » (Ibid.). On ne peut donc accommoder ce qui relève d’un goût, d’un plaisir personnel ou d’un désir.
L’Avenir de la Laïcité
La Laïcité n’est pas le laïcisme, ou une sorte de cloison dorée réservée aux initiés ayant atteint un certain degré de puissance. Elle ne s’enferme donc pas exclusivement dans des déclaration propagandistes de type « séparation de l’Église et de l’État » ou encore « la neutralité de l’État à l’égard des religions » ou bien « la sortie de la religion de l’espace public ». Ces formules peuvent dire quelque chose de la Laïcité, mais il n’y a pas que cela, car « la Laïcité repose plutôt sur une pluralité de principes ; chacun remplissant des fonctions particulières » (p. 29). Les acteurs démocratiques devraient apprendre à privilégier, à côté des problèmes de distribution économique à tenir compte des diversités humaines, sociales, religieuses, morales et culturelles de l’individu des temps démocratiques d’autant plus que la diversité est inhérente à toute société démocratique. La religion étant une vision du monde comme d’autres visions, il n’est pas nécessaire de l’isoler en la confinant dans l’espace privé.
La question de la Laïcité dans les sociétés démocratiques et libérales étant en soi une question complexe, il est clair que pour qu’elle essaie de ne pas dégénérer en haine de la religion, qu’elle tienne compte de certaines circonstances et apprennent à s’adapter des fois. Les auteurs l’ont démontré à la fin de leur livre. La question des accommodements raisonnables est aussi complexe que celle de la Laïcité car elle se heurte à la multiplication des demandes. Doit-on tout aménager ? De nos jours avec les extrémismes religieux qui ne laissent désormais personne indifférent l’on se demande sans cesse si les gouvernements en fonction des demandes d’accommodement de la laïcité succomberont au piège de la manipulation du signe ou de la présence ou encore des habitudes religieuses qui n’ont aucun impact social. Et si les religions et autres valeurs traditionnelles et culturelles s’adaptaient ?
La question reste ouverte à tous, mais pour les auteurs, envers et contre tout et parce qu’ils raisonnent d’abord en tant que philosophes, soucieux de la liberté de l’individu rationnel et responsable, « ce ne sont pas les convictions religieuses en soi qui doivent jouir d'un statut particulier, mais bien l'ensemble des croyances fondamentales qui permettent aux individus de structurer leur identité morale » (p. 115-116). Étant donné que la dynamique libérale rime avec la question de la souveraineté de l’individu, l’un des vrais problèmes de la Laïcité de nos jours est réellement le problème de la liberté de l’individu, de comment l’État Laïque permet à l’individu de se déployer dans un conditionnement qui tienne compte de l’égalité, de la liberté et des diversités.
La laïcité ou l’histoire d’une résistance.
Résistance à quoi ? À l’uniformité. La laïcité, dans son principe n’est ni conformiste ni tyrannique. Elle refuse de s’enfermer dans une définition prête à porter. Sa vocation porte en elle une capacité à s’adapter. En théologie, on parlerait d’inculturation autrement dit la capacité d’adapter quelque chose (Évangile chez les Chrétiens) dans dans une culture donnée. Ce qui n’est ni « acculturation » et encore moins « Inculte » mais plutôt incarnation d’un modèle dans les différents modes de vie et dans la gouvernance d’une démocratie qu’elle soit républicaine ou pluraliste.
Au terme de notre recension, nous sommes tentées de poser la question suivante : Doit-on réformer ou corriger la Laïcité ? Ce livre a été écrit il y a exactement six ans et nous démontre que la Laïcité est aussi l’histoire d’un dialogue permanent. Il vient d’être réédité en 2016. Il demeure d’une pertinence inégalable encore aujourd’hui car la question de la religion et de sa place dans l’espace public démocratique est d’une acuité ineffable. On ne pourra pas nier que ce livre, comme tout livre a ses limites et nous laisse dans des questionnements multiples, cependant l’une de ses originalités c’est qu’il représente pour les penseurs de notre époque une sorte de Galerie contemporaine des questions démocratiques de la religion et de la Laïcité. Pour une Laïcité ouverte, Maclure et Taylor jugent essentiel l’alliance réelle de l’éthique avec le politique.
Pénélope Mavoungou
Références :
Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience, La Découverte, coll. « La Découverte », 2010, 164 p., EAN : 9782707166470.
Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience, Montréal, Boréal, 2010, 164p.,
Pierre Manent, Intérêt privé, intérêt public, « L’actualité de Tocqueville », CPPJUC, N°19, Caen, 1991, p. 69-71.
La question de la Tyrannie dans De Regno de Thomas d'Aquin
Saint Thomas d’Aquin (1225-1244), philosophe et théologien italien nous offre dans De regno une véritable critique de l’autocratisme. Pour lui, « la tyrannie est le pire des régimes ». Nous suivrons sélectivement son argumentation en présentant les caractéristiques d’un tel régime, ses conséquences et comment il propose de s’en débarrasser. L’auteur pense clairement à partir des catégories bibliques et chrétiennes. A cet égard, les notions de péché et de châtiment éternel sont évoquées. Un tel ouvrage est pertinent car il est possible d’employer sa grille comme instrument critique contre les politiques rétrogrades d’Afrique Centrale.
Le tyran et la prédation du bien commun
Le tyran se caractérise par un gouvernement injuste à travers lequel, il profite du bien commun dont il en fait une propriété exclusive. Saint Thomas le démontre dans une phrase limpide : « Plus un gouvernement s’éloigne du bien commun, plus il est injuste » ; l’Aquinate poursuit en ces termes : « Un gouvernement est donc d’autant plus injuste qu’il s’éloigne davantage du bien commun. Or on s’éloigne plus du bien commun dans l’oligarchie, où c’est le bien d’un petit nombre qui est recherché, que dans la démocratie, où c’est le bien d’un grand nombre; et l’on s’éloigne davantage encore de ce bien commun dans la tyrannie où le seul bien d’un seul homme est recherché. En effet, le grand nombre est plus proche de l’universalité totale que le petit nombre, et le petit nombre qu’un seul individu. Le gouvernement du tyran est donc le plus injuste qui soit. » (Saint Thomas d’Aquin). Du point de vue moral, le tyran est cupide et il a un gouvernement arbitraire qui méprise le droit et la justice.
La tyrannie abêtit les populations
Saint Thomas mène sa critique de la tyrannie dans ses effets négatifs sur les populations assujetties. La tyrannie a un effet pervers sur les populations chez qui est entravé le sens du progrès moral. Le tyran sème la division parmi la multitude. Son arme principale est la peur par l’usage de la terreur. Que dit Saint Thomas d’Aquin ? « Il est naturel aussi que des hommes nourris dans la crainte s’avilissent jusqu’à avoir une âme servile et deviennent pusillanimes à l’égard de toute œuvre virile et énergique, on peut le constater d’expérience dans les provinces qui furent longtemps sous la domination de tyrans. » (Saint Thomas d’Aquin). Le danger de la tyrannie est la production d’assujettis ; des peureux qui n’ont plus confiance en eux-mêmes et qui ploient en définitive sous la tyrannie d’une personne.
Le tyran abhorre le gouvernement par la raison il se comporte comme un animal. Il gouverne par la passion ; en cela, il est assimilé à une bête qui mange les plus faibles. Que dit Saint Thomas ? « L’homme qui gouverne en rejetant la raison et en obéissant à sa passion ne diffère en rien de la bête, ce qui fait dire à Salomon (Ibid., XXVIII, 15) : "Un lion rugissant, un ours affamé, tel est le prince impie dominant sur un peuple pauvre." C’est pourquoi les hommes se cachent des tyrans comme des bêtes cruelles, et il semble que ce soit la même chose d’être soumis à un tyran ou d’être la proie d’une bête en furie. » (Saint Thomas d’Aquin).
La domination des tyrans n’est pas éternelle
Un pouvoir odieux ne peut durer indéfiniment puisqu’il est exécré par la multitude. La capacité insurrectionnelle est toujours présente quand un tel gouvernement opprime la multitude. Ne pouvant pas compter sur la fidélité, le tyran règne par la crainte. Celle-ci est un fondement fragile. Le tyran n’a pas confiance. La peur qu’instille le tyran n’est pas éternelle car elle est vite muée en révolte contre les iniquités. « La crainte est un fondement débile. Car ceux qui sont sous l’emprise de la crainte, s’il arrive une occasion qui leur laisse espérer l’impunité, se révoltent contre ceux qui les commandent, avec d’autant plus d’ardeur que leur volonté était plus contrainte par cette seule crainte. De même une eau contenue par violence, s’écoule avec plus d’impétuosité quand elle a trouvé une issue. Mais la crainte elle-même n’est pas sans danger, car un grand nombre sous l’effet d’une crainte excessive sont tombés dans le désespoir. Or quand on désespère de son salut, on se précipite souvent avec audace vers n’importe quelles tentatives. La domination d’un tyran ne peut donc pas être de longue durée. » (Saint Thomas d’Aquin)
Quel sort faudrait-il réserver au tyran ?
Un royaume mérite de se prémunir contre la possibilité qu’a un roi de dégénérer. Cela requiert un choix discerné des personnes parmi lesquelles le choix de gouverner s’opère. « Il faut empêcher la royauté de se changer en tyrannie Puisque donc il faut préférer le gouvernement d’un seul, qui est le meilleur, et puisqu’il lui arrive de dégénérer en tyrannie, qui est le pire gouvernement, comme il apparaît d’après ce que nous avons dit plus haut, il faut travailler avec un zèle diligent à pourvoir la multitude d’un roi de telle sorte qu’elle ne tombe pas sous la domination d’un tyran. » (Saint Thomas d’Aquin)
Saint Thomas d’Aquin réfléchit à partir des catégories bibliques. Il énumère tout d’abord un choix mené selon ce que la personne choisie puisse ne pas déchoir dans la tyrannie. Cela passe par une décision discernée selon ce que Dieu veut : « D’abord, il est nécessaire que ceux à qui revient ce devoir élèvent à. la fonction de roi un homme tel qu’il ne soit pas probable qu’il tombe dans la tyrannie. C’est pourquoi Samuel, se confiant à la Providence de Dieu pour l’établissement d’un roi, dit au premier Livre des Rois (XIII, 14) : "Le Seigneur s’est cherché un homme selon son coeur." » (Saint Thomas d’Aquin) « Ensuite, la direction du royaume doit être organisée de telle sorte, qu’une fois le roi établi, l’occasion d’une tyrannie soit supprimée. En même temps son pouvoir doit être tempéré de manière à ne pouvoir dégénérer facilement en tyrannie. Comment cela doit se faire, nous le considérerons par la suite. » (Saint Thomas d’Aquin)
Comment faudrait-il s’opposer au roi s’il tombe dans la tyrannie ? comment s’opposer à la tyrannie ? Pour Thomas d’Aquin, la tyrannie peut être tolérée si elle n’a pas d’excès ; certes, écrit Thomas d’Aquin, « pour un temps » ; il qualifie cette tyrannie de « modérée » ; il ne souhaite pas voir une opposition non discernée à un tyran, si cela entraîne des dangers énormes. S’opposer au tyran n’entraîne pas nécessairement la victoire sur lui ; et il sévira davantage. Pour Saint Thomas un tel échec entraînera de profondes dissensions au sein de la population.
Le tyran peut être renversé mais la réussite peut entraîner la division en factions rivales. Laissons la parole à Saint Thomas qui évoque également d’autres cas de résistance au tyran et les conséquences qui en découlent : « Et certes, s’il n’y a pas excès de tyrannie, il est plus utile de tolérer pour un temps une tyrannie modérée, que d’être impliqué, en s’opposant au tyran, dans des dangers multiples, qui sont plus graves que la tyrannie elle-même. Il peut en effet arriver que ceux qui luttent contre le tyran ne puissent l’emporter sur lui, et qu’ainsi provoqué, le tyran sévisse avec plus de violence. Que si quelqu’un peut avoir le dessus contre le tyran, il s’ensuit souvent de très graves dissensions dans le peuple, soit pendant l’insurrection contre le tyran, soit qu’après son renversement, la multitude se sépare en factions à propos de l’organisation du gouvernement. La multitude peut se défaire du roi ; mais selon quelle procédure ? Une fois établi cette nuance de supporter le tyran pour cause de fidélité à l’évangile, pour Saint Thomas, « C’est l’autorité publique qui doit supprimer le tyran. Mais il semble que contre la cruauté des tyrans il vaut mieux agir par l’autorité publique que par la propre initiative privée de quelques-uns. » (Saint Thomas d’Aquin)
Pour chasser un tyran, « Il faut recourir à une autorité supérieure, s’il y a lieu ». pour le docteur angélique, Il faut aussi recourir à Dieu, qui a pouvoir sur le tyran. Une question controversée est soulevée par une position de Saint Thomas ; en effet, il pense que « Dieu permet les tyrans pour punir le peuple » ; il le justifie avec des positions bibliques. La tyrannie est la conséquence du péché du peuple hébreu. Cette position tient-elle ?
Saint Thomas s’interroge à partir de la terminologie chrétienne du « châtiment éternel » ; sera-t-il réservé au tyran ? laissons parler Saint Thomas d’Aquin : « Le tyran mérite le châtiment éternel. Le tyran est en outre privé de la béatitude la plus élevée, qui est due comme récompense aux rois, et, ce qui est plus grave, il se réserve le plus grand tourment comme châtiment. Si, en effet, celui qui dépouille un homme, le réduit en servitude, ou le tue, mérite le plus grand châtiment qui, quant au jugement des hommes, est la mort, quant au jugement de Dieu, la damnation éternelle, à combien plus forte raison faut-il penser que le tyran mérite les pires supplices, lui qui vole partout et à tous, qui entreprend contre la liberté de tous, qui tue n’importe qui pour le bon plaisir de sa volonté ? » (Saint Thomas d’Aquin) Saint Thomas, après avoir déconstruit la figure du tyran propose en retour un gouvernement où le roi emploie des valeurs constructives.
En somme, la critique thomiste de la tyrannie peut se lire en contexte et elle demande donc aux philosophes d’Afrique Centrale d’écrire des textes critiques à l’endroit de ce qui se passe en termes d’arbitraire ; et qu’ainsi, les générations à venir puissent éviter de sombrer dans ce jeu qui produit des citoyens peureux, incapables de se poser comme citoyens libres. Ce livre parle à l’Afrique Centrale, il pourrait être employé comme instrument de critique de la politique comprise comme pouvoir à conserver par tous les moyens, y compris au mépris de l’éthique.
L’ouvrage est dense et il serait intéressant de s’interroger sur les pratiques dénoncées par Saint Thomas afin d’élaborer une véritable critique de l’arbitraire politique. A partir de ce livre il est possible de questionner à la fois l’accaparement du pouvoir politique qui se singularise par une prédation des biens et une résistance très souvent réprimée dans le sang. Faut-il pour autant, mener un renversement des tyrans par des procédures institutionnelles s’ils ne parviennent pas à opérer ce qui est demandé d’eux ? La difficulté d’une telle question provient du caractère vide de la coquille institutionnelle que le tyran a la force de créer. Ainsi, le vote, l’assemblée, n’obéissent plus aux critères de la représentation du peuple mais ces instruments de choix sont galvaudés par des gens sensés représenter le peuple mais qui ne se représentent qu’elles-mêmes.
Le livre est disponible : http://docteurangelique.free.fr/bibliotheque/opuscules/20deregno.htm
Akono François-Xavier.
Politiques de l'inimitié - Achile Mbembe
Politiques de l’inimitié circule entre une immersion dans le « passé » des questions liées au mépris racial et une critique du « présent » tourmentée par le terrorisme et le contreterrorisme. Ces deux dimensions du temps sont mises en scène par la question de la violence. Achille Mbembe réfléchit sur le soin psychiatrique chez Frantz Fanon, à l’ombre duquel il élabore une relecture critique de l’histoire de l’humanité. Le livre a été conçu en toute liberté qui permet au lecteur d’entrer par la porte de son choix. De ce fait le lecteur ou la lectrice peut circuler dans cette œuvre dense qui offre une occasion de méditer à la fois sur ce qui se passe ; (autrement dit, « penser l’événement » dans le sens harendtien) et évaluer ses racines historiques. Les démocraties libérales sont questionnées dans leur face-à-face avec le terrorisme. Le contreterrorisme qui en résulte évacue-t-il à son tour le refus du droit ?
L’introduction du livre, intitulée, « l’épreuve du monde », est un porche qui présente succinctement l’argumentation de l’ensemble. La réflexion de Mbembe porte «sur la reconduction à l’échelle planétaire de la relation d’inimitié et ses multiples reconfigurations dans les conditions modernes. Le concept platonicien de pharmakon – l’idée d’un médicament qui opère à la fois comme remède et comme poison – en constitue le pivot. S’appuyant en partie sur l’œuvre politique et psychiatrique de Frantz Fanon, l’on montre comment, dans le sillage des conflits de la décolonisation, la guerre (sous la figure de la conquête et de l’occupation, de la terreur et de la contre-insurrection) est devenue, au sortir du XXe, le sacrement de notre époque » (p. 8)
Comment argumente-t-il pour démontrer le fait que guerroyer caractérise notre temps ?
L’ouverture du chapitre 1 intitulé « La sortie de la démocratie », formule la visée du livre. « L’objet de ce livre est de contribuer, à partir de l’Afrique où je vis et travaille (mais aussi à partir du reste du monde que je n’ai eu de cesse d’arpenter), à une critique du temps qui est le nôtre–le temps du repeuplement et de la planétarisation du monde sous l’égide du militarisme et du capital et, conséquence ultime, le temps de la sortie de la démocratie (ou de son inversion) » (p. 17)
La déconstruction qui est la méthode employée sous-entend toutefois l’inexistence d’un point de vue de surplomb, en récusant un « universalisme abstrait » (p. 17) et conquérant. Nos discours sont forcément « provinciaux »
Par sa plongée dans le passé du mercantilisme Achille Mbembe examine la part honteuse de ce système : « aussi bien le commerce négrier que la colonisation coïncidèrent en grande partie avec la formation de la pensée mercantiliste en Occident, quand ils n’en furent pas purement et simplement aux origines. Le commerce négrier fonctionnait à l’hémorragie et à la ponction des bras les plus utiles et des énergies les plus vitales des sociétés pourvoyeuses d’esclaves. » (p. 18). Un commerce de dupe qui conduit à s’interroger. Car, « la démocratie à esclaves » est « une démocratie raciste » (p. 29) Pouvait-on affirmer que la démocratie américaine où se juxtaposaient « les semblables » et les « non semblables » était une démocratie ? Quelle est cette démocratie qui employait le lynchage et qui tenait à l’écart « l’esclave-marchandise » dont elle profite néanmoins ? Car il est évident que la plantation profite aux personnes qui ont de l’argent et le multiplient. Il a fallu institutionnaliser l’injustice pour jouir. Cela, par l’imbrication entre la colonie, la démocratie et la plantation (p. 32). Une telle intrication, part du constat empirique, de la condition nègre : « être né aux États-Unis (cas de 90 % d’entre eux en 1860) ou procéder d’une descendance mixte (13% d’entre eux à la même période) ne change rien à l’état de bassesse auquel ils sont réduits, ni à l’ignominie dont ils sont frappés, et qui est transmise de génération en génération, sous la forme d’un héritage empoisonné » (p. 28) Mbembe évoque aussi les différentes critiques de la démocratie en provenance de l’anarchisme, du socialisme et du syndicalisme.
Comment ne pas évoquer l’Afrique où l’on constate tout simplement, la reconduction de la violence du colonat dans les temps des partis uniques et iniques et des pseudo démocraties ?
Dans ce continent, la terreur étatique, s’est caractérisée comme une répression de la contestation ; les potentats emploient « une répression tantôt sournoise, tantôt expéditive, brutale, sans retenue » (p. 51) à travers des emprisonnements, arbitraires, des fusillades ignobles, une instauration de l’état d’exception, et d’autres formes de « coercition économique » (p. 51). En plus de cette pratique de la répression, « les luttes politiques ont eu tendance à être réglées par la force, la circulation des armes au sein de la société devenant l’un des principaux facteurs de division et un élément central dans les dynamiques de l’insécurité » (p. 52). L’État n’a plus la propriété de la « violence » puisque plusieurs acteurs le lui discutent. Le chapitre examine surtout le fait que les démocraties libérales, confrontées au terrorisme sortent d’elles-mêmes et ainsi emploient la violence pour faire face à la violence.
Le chapitre 2 s’intitule, « la société d’inimitié ».
Ce monde « décidément, est à la séparation, aux mouvements de haine, à l’hostilité et, surtout à la lutte contre l’ennemi, en conséquence de quoi les démocraties libérales, déjà fort lessivées par les forces du capital, de la technologie, sont aspirées dans un vaste processus d’inversion » (p. 62).
Achille Mbembe emprunte le concept d’inimitié à Carl Schmitt. Dans notre monde actuel, ce concept « renvoie à un antagonisme suprême » (p. 70). L’ennemi est présent et on développe de la haine contre lui. L’ennemi est celui qui fait peur et qui affole. « L’objet affolant ». « Hier, ces objets avaient pour noms privilégiés, le Nègre et le Juif. Aujourd’hui Nègres et Juifs ont d’autres prénoms - l’islam, le musulman, l’Arabe, l’étranger, l’immigré, le réfugié, l’intrus, pour n’en citer que quelques-uns » (p. 62.). Il prend le soin de préciser que les démocraties libérales sont hantées par le « désir d’apartheid » ; elles se singularisent par des procédés de séparation et du repli sur soi. De là prospère le racisme décomplexé et gaillard. De cette idée de séparation, se perçoivent les pratiques israéliennes contre les palestiniens. C’est le refus de vivre ensemble côte à côte comme dans le cas du colonat. En clair, il faut comprendre que ce désir d’apartheid se complexifie davantage avec le surgissement du terrorisme et du contreterrorisme.
« Quant à la guerre chargée de vaincre la peur, elle n’est ni locale, ni nationale, ni régionale. Sa surface est planétaire et la vie quotidienne son théâtre privilégié d’action. » (p. 77). Il faut donc comprendre par là que la guerre devient permanente contre un ennemi qui du dehors ou en dedans menace et frappe. Ce qui est palpable et observable, est la capacité de nuisance où des gens décident de se supprimer en supprimant des membres de la communauté qu’ils exècrent. Les sociétés occidentales subissent-elles la loi du Talion, du fait de leur fomentation des guerres loin de la vie de leurs citoyens ?
Pour Mbembe, « le nanoracisme hilare et échevelé, tout à fait idiot, qui prend plaisir à se vautrer dans l’ignorance et revendique le droit à la bêtise et à la violence qu’elle fonde – tel est donc l’esprit du temps » (p. 87), temps dominé par les débats futiles entre autochtonie et « allogènité » ; mais temps du monde pluriel. « La question de l’appartenance demeure entière. Qui est d’ici et qui ne l’est pas ? Que font chez nous ceux et celles qui ne devraient pas s’y trouver ? Comment s’en débarrasser ? Mais que veut dire « ici » et « là-bas » à l’ère de l’entrelacement de mondes mais aussi de leur rebalkanisation ? » (p. 89)
Le chapitre 3 s’intitule, « Pharmacie de Fanon ».
L’auteur relit la pensée de Fanon en une double perspective. Il écrit, à cet effet, que « l’on s’attaque directement à la tension entre le principe de destruction – qui sert de pierre angulaire des politiques contemporaines de l’inimitié – et le principe de vie ». Par conséquent Achille Mbembe s’intéresse à la pensée fanonienne relative à la décolonisation. Dans quelle mesure la violence peut-elle être un travail qui débouche « sur le principe de vie » (p. 92) et par là rendre possible « la création du neuf » (p. 92). Pour Fanon, la violence est nécessaire ; car elle permet de s’attaquer au « système colonial » (p. 107) ainsi qu’à tous les « systèmes d’inhibition » qui fabriquent la peur, les sentiments d’infériorité ; cela dans l’objectif de parvenir à la création « d’autres formes de vie » (p. 107). Le principe destructif caractérise le monde de la guerre.
Le chapitre analyse surtout les différentes formes de racisme qui produisent des souffrances chez les colonisés blessés traumatisés. Cet autrui dominé se sent dans « une position instable » (p. 111) ; malgré cela, le nègre fait peur. Dans l’imaginaire colonial, il est d’abord un agresseur. « Objet effrayant, il éveille la terreur » (p. 114). La reconstruction de soi comme sujet demande d’opter pour une culture du refus de la soumission. « Le sujet fanonien (…) naît au monde et à soi à travers ce geste inaugural qu’est la capacité de dire non. Refus de quoi sinon de se soumettre, et d’abord à une représentation. Car dans les contextes racistes, « représenter » est la même chose que « défigurer ». La volonté de représentation est au fond une volonté de destruction.» (p. 118). Faire face demande de s’organiser contre ce qui opprime.
Dans ce contexte algérien colonial violent, Fanon exerce sa relation de soin. Il traite les dépressifs et ceux qui ont un sentiment de perte. Fanon s’intéressait aux victimes produites par la société d’inimitié, l’impuissance sexuelle des gens, les femmes violées, les personnes victimes de la torture, les anxieux, les tueurs et les tortionnaires, des orphelins, ou des gens ayant perdu un membre de famille, des français et des algériens ; les gens à la lisière du désespoir, etc. Il s’intéressa aux gens souffrant de troubles mentaux et de troubles psychiques. Fanon voulait surtout aider le malade en vue de le « rétablir dans son être et dans ses relations avec le monde » (p. 125) ; ce qui nécessite tout un travail d’accompagnement de la personne malade.
La lecture de Fanon permet à Mbembe de proposer une « éthique du passant », pour ramer à contre courant de l’univers de la violence, l’auteur propose de « devenir-homme-dans-le-monde » (p. 176). Vouloir décider d’être humain, revient à « apprendre à passer constamment d’un lieu à un autre » (p. 176) dans des vécus de « solidarité et de détachement » (p. 177).
En somme, Politiques de l’inimitié renvoie l’humanité à faire une révision de vie si elle veut vivre harmonieusement dans la rencontre des différents faisceaux constitutifs du monde des humains.
Akono François-Xavier.
Références
Achille Mbembé, Politiques de l'inimitié, Paris, Éditions la Découverte, 2016.
Les Irremplaçables de Cynthia Fleury
La notion de démocratie nous est familière. Nous parlons de la démocratie, nous croyons en la démocratie. Qu’elle soit grecque nous en sommes convaincus, puisqu’elle y tire son origine. Qu’elle soit adaptable, nous pose tout de même des questions, même si nous demeurons conscients que la démocratie fonctionne bien en Amérique alors qu’elle n’est pas d’origine américaine. Mais pourquoi ne marche-t-elle pas en Afrique ? Là est une autre question à laquelle peu de personnes répondent. Finalement comment expliquer cette immanence et cette permanence de l’idée de démocratie dans le monde actuel ? Cynthia Fleury, spécialiste de la pensée politique et des pathologies de la Modernité, consacre depuis quelques années déjà ses travaux sur la question de l’idéal politique. Ses oeuvres sont, par ailleurs, empreintes d'une touche toute intimiste qui ressort probablement de sa double formation de philosophe et de psychanalyste sans compter son expérience en tant qu’actrice sociale engagée et professeure. Dans Les Irremplaçables, elle repose la question de la liberté individuelle en la présentant non point comme un danger pour l’État de droit, mais comme une nécessité incontournable pour l’évolution de la démocratie. Elle croit que l’individu, en tant que sujet, est irremplaçable en démocratie. Ceci relève quasiment de la conviction, car briser cette irremplaçabilité, c’est briser la société. Seulement cette consécration de l’individu n’a rien à voir avec l’individualisme que plusieurs auteurs de la philosophie politique pointent du doigt comme étant l’élément fondamental de la déstructuration de la démocratie. Dans cet essai publié en 2015, l'auteur propose une alternative à l’individualisme souvent déduit de l’individu en proposant la prise en compte de l’idée d’individuation. Pourquoi l’individuation pour l’État de droit ? Parce que l’État de droit dévalorise, travestit et désingularise un peu le sujet en le présentant des fois comme étant remplaçable. Détruire le sujet c’est s’autodétruire pour l’État de droit car il n’y a pas d’état de droit sans individu.
Avant de commencer, pour des raisons d’ordre sémantique, nous tenons à préciser ce que sont l’individualisme d’une part et l’individuation d’autre part. Le terme individualisme désigne une posture qui privilégie les intérêts, les droits et valeurs de l'individu par rapport à tous les groupes sociaux. L'intérêt individuel y supplante l’intérêt général. Deux principes encadrent l'individualisme: la liberté individuelle et l’autonomie morale. Quant à l’individuation, l’auteur écrit : « La notion d’individuation fait écho à celle de l’individualisme pour la critique, et rappelle qu’un individu dans l’État de droit doit pouvoir devenir sujet » (p. 11).
L’Essai est divisé en trois chapitres.
Dans le premier chapitre, la philosophe parle de l’individuation et de son rapport avec l’État de droit. Elle présente la production de l’individuation et appelle à redécouvrir le « connais toi-même » et le « rien de trop » à partir de trois principes. Le Γνῶθι σεαυτόν « gnôthi seauthon » ou le « connais-toi toi-même » qui marque l’ouverture au monde et impose en même temps des limites parce que lorsqu’on apprend à se connaître on apprend à reconnaître l’autre et à le valoriser ; et le Μηδὲν ἄγαν « Mêden agan » ou le « rien de trop » qui impose des limites, à l’instar de la médiété aristotélicienne, une valeur éthique, sociale et intellectuelle.
Le premier principe d’individuation passe par l’« imaginatio vera » ou « l’imagination vraie » qui a pour socle l’ouverture à l’autre, au monde et à la vision intuitive. L’imagination ouvre au réel. Le deuxième principe se résume dans le « pretium doloris » ou la question du prix de la douleur qui parle de l’homme comme un capax doloris (capable de douleur (souffrance)) du fait qu’il assume certaines douleurs pour pouvoir accéder au réel. Penser devient alors « risquer », donc assumer une douleur. Et enfin le troisième principe « vis comica » ou la « force comique » qui consacre l’humour dans la connaissance et dans le rapport avec autrui. On peut ici parler de l’ironie socratique qui ne limite pas l’humour à la détente, mais aussi à sa capacité créatrice de propulser "vers". L’humour possède dès lors un mouvement tonifiant pour sauvegarder le sujet de la domination. Telles sont ainsi présentées les quatre figures au cœur du processus d’individuation.
Dans le deuxième chapitre, il est question de la question du Pouvoir que Cynthia Fleury considère comme une religion continuée. Elle montre que le Pouvoir tient par la croyance et considère que les citoyens désinhibés renforcent ce spectre du pouvoir. Elle pose donc directement le problème du démantèlement de la notion de « Pouvoir » en se questionnant sur la légitimité de l’exercice de celui-ci lorsque l’individuation est effective. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que le pouvoir qu’il s’agit de déconstruire ici c’est le pouvoir dogmatisé ou plutôt disons le pouvoir absolu (déifié) qui heurte l’individualité des citoyens en les conduisant à démissionner de la sphère publique. Grande lectrice de Foucault, Fleury reste convaincue, comme l’affirme ce dernier, que le pouvoir est de nature circulaire. D’où l’individuation pose des pré-requis pour sa réalisation. Voilà pourquoi pour s’individuer, il faut sortir de l’état de minorité ; se réapproprier son temps, sa langue et sa capacité d’action. Ceci dit, « toute tentative de désindividuation prend appui sur la déverbalisation » (p. 11).Notons aussi que dans cette prise en charge du Soi, la philosophe ne fait pas l’économie de la dimension historique. Pour elle si l’histoire est d’abord le récit des évènements passés, elle est aussi le levier de la conscience humaine, car elle rappelle à l’individu que l’homme n’a pas toujours été sous le joug d’une domination. Aussi, estime-t-elle que l'histoire a pour fonction de rappeler que « l'individuation a eu lieu, que si elle est une création journalière, elle n'en demeure pas moins principielle, et de toute éternité présente, comme la potentialité même de l'homme... »
Le troisième chapitre concerne le rapport de l’Irremplaçabilité à l’éducation. L’auteure pointe la faiblesse de l’éducation qui a oublié « la dimension de la lutte » (p. 173), alors que pour sortir de l’état de minorité, l’éducation est incontournable. Elle estime en outre que l’éducation devrait s’armer pour être à même de répondre à la formation au processus d’individuation. Elle écrit d’ailleurs que « le désœuvrement parental n’est d’ailleurs que le nom particulier d’un désœuvrement plus général qui touche tous les acteurs de la société dans l’appréhension de leur responsabilité (jusqu’où cette vie qui est la leur les concerne-t-elle ?) » (p. 173). De ce fait la philosophe insiste sur l’idée que l’éducation à l’individuation est l’œuvre de toute une vie qui demande discipline et soin. S’inspirant de la vision kantienne du « soin », elle affirme que le soin c’est « précisément cette précaution que prennent les parents pour éviter que les enfants ne fassent un usage nuisible de leur force. Car qu’est-ce qu’un individu accompli si ce n’est celui qui sait user correctement de sa force, sans en abuser, sans se mettre lui-même en danger ? » (p. 174).
En somme pour Cynthia Fleury, toute éducation fut-elle domestique doit faire « écho à l’éducation plus générale de l’humanité, et ce pour alimenter plus globalement la notion de progrès » (p. 175). L’éducation doit demeurer la priorité première de l’État, parce qu’elle forme l’humain qui est l’acteur assuré de la Nation. C’est pourquoi on ne peut parler d’éducation scolaire sans éducation domestique.
S’éduquer à l’irremplaçabilité.
À travers ce sous-titre l’auteure propose les clés d’une éducation à l’irremplaçabilité (le caractère de ce qui est irremplacable). Elle permet de conserver l’existence de manière continue à travers la participation à la vie sociale, à la gestion de la responsabilité et à l’action, la production des personnalités effectives et la discipline. À la fin de son livre l’auteure fait un clin d’œil en direction de la question du travail dont elle met en avant les dimensions de solidarité et non simplement de rendement
En conclusion...
L’essai de Cynthia Fleury est d’une pertinence indéniable car il questionne le cœur de la démocratie moderne qui en consacrant l’exaltation de l’individu, l'a confondu avec l’individualisme. Redonnant à la philosophie politique ses lettres de noblesses, elle rejoint de ce fait des grands auteurs comme Alexis de Tocqueville qui, dans De la démocratie en Amérique, n’a pas hésité à fustiger la question de l’individualisme comme étant le travestissement des principes démocratiques de liberté et d’égalité. La thèse développée ici questionne aussi le rapport des philosophies politiques Libertariennes, comme celle de Nozick par exemple, en montrant que le retrait social de l’individu n’est pas la seule condition de l’exercice de la liberté individuelle, car ce qui est important ce n’est pas l’indifférence démocratique mais la remise du Sujet au cœur du Collectif. Pour finir disons que l’auteure nous apprend qu’il ne suffit pas d’opter pour la démocratie ou de se déclarer démocrate pour faire préserver la démocratie. Etre démocrate est un travail qui implique le soi, les autres et la société. C’est pourquoi le risque de l’irremplaçabilité doit toujours être considéré comme le risque, sans risque, de la relation à l’autre.
Pénélope Mavoungou
Références
Cynthia Fleury, Les Irremplaçables, Paris, Gallimard, 2015
Robert Nozick, Anarchie, État et utopie, Paris, Puf, 1974.
Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Paris, Seuil, coll « Esprit », 1983.
Philippe Raynaud, Tocqueville. De la démocratie en Amérique, Paris, Éditions Flammarion, 2010.
Nihilisme et négritude. Les arts de vivre en Afrique, de CELESTIN MONGA.
A ouvrir cet ouvrage récent, le lecteur est frappé d’emblée par la page de dédicace ; Célestin Monga nomme ses Grands-Maîtres, Fabien Eboussi Boulaga, Ambroise Kom, François Ekoumou, son Professeur de Français d’un Lycée de Douala ; et, honneur des honneurs, Jean Marc Ela, celui qui a été accueilli par les Ancêtres ! Aux côtés de ces veilleurs, il cite ceux qu’il nomme « boussoles et anges gardiens », Kephren et Maélys, son jeune fils et sa jeune fille. Si la dédicace est un acte charitable de reconnaissance, elle invite ici à rentrer dans la contrée philosophique de l’auteur constituée ici d’une appropriation et du vécu du nihilisme dans la trame existentielle de l’Afrique sub-saharienne. Ce, au travers des tranches de vie où l’esthétique et la métaphysique se côtoient. Où l’éphémère est rendu par une poétique de la vie.
Quelle est la trame de l’ouvrage ? La trame est pérégrine en ce que l’auteur, dans un exercice quasi autobiographique qui lui est déjà familier conduit le lecteur à relire ses carnets de route tout en faisant de temps à autre des incursions vers des analyses sociologiques et philosophiques. Les notes de voyages éparses, à la fois de son titre de fonctionnaire à la Banque Mondiale, et d’auteur prolifique, dévoilent des facettes des peuples sub-sahariens et certaines diasporas. La problématique est donnée par le titre de l’introduction de l’ouvrage, « Nihilisme : variations africaines » ; en fait, « Comment contribuer à résorber les déficits d’amour propre, de confiance en soi et de leadership qui engourdissent les esprits et diluent le bonheur ? » ( 25-26). Quelle est la philosophie sous-jacente aux transformations sociales en cours en Afrique subsaharienne. Le défi étant de parvenir à analyser le « substrat philosophique et les schémas de raisonnement qui se dissimulent derrière les comportements les plus banals de la vie quotidienne »(30-31) ce, sans généralisations hâtive. Ici, la Négritude est une philosophie de vie qui ne saurait être aujourd’hui ramenée à ce qu’elle était hier ; c’est une conscience imbriquée entre l’ici et l’ailleurs en chaque Africain dans ses variations et ses différences ; il est davantage question d’une africanité syncrétique. Dans ce contexte, que dit l’auteur de lui-même ? « Je me définis donc comme citoyen du monde certes, mais africain malgré tout » (37) Qui est l’Africain ? (identité d’être) ; Comment savons nous ce que nous sommes ? (modalité existentielle) Quels critères indiscutables nous définissent aujourd’hui ? Comment penser l’altérité dans ce village global où l’Afrique n’est « d’ailleurs qu’une invention ? »(37)
Plusieurs thèses parcourent l’ouvrage ; les anecdotes convoquent la réflexion ; l’étonnement est sarcastique et méditatif devant la folie du roi et la nudité des postérieurs exposée sous prétexte d’affirmation politique pour cause de revendication de conférence nationale au Cameroun. La thèse se déroule en six chapitres dont nous allons brièvement présenter la substance.
Le Chapitre 1 est intitulé « Les ruses du désir. Economie politique du mariage » ; il débute par une histoire fort cocasse où Célestin Monga, de passage au Burkina Faso dans le cadre d’une mission du FMI est un peu déçu des fruits de l’hôtel ; il se rend par conséquent au marché de fruits de Koulaba Ouagadougou (Burkina Faso) se procurer des fruits de bien meilleure qualité ; il se fait accompagner à bord de sa Mercedes Noire rutilante (digne de son rang de Chef de Mission), de son chauffeur Burkinabè qui lui servira d’interprète ; ayant acheté au double du prix proposé, la mère de la vendeuse, souhaite qu’il emmène avec lui sa fille ; Pourquoi la mère, veut-elle « offrir » à un inconnu, sa fille rencontrée au marché ? (55). Cet épisode conduit l’auteur à penser les déterminants de l’amour dans les couples africains. Pourquoi les femmes africaines se marient-elles ? C’est sans doute pour « donner de l’épaisseur à leur existence, et investir des territoires psychologiques auxquels elles n’accèderaient pas toutes seules »(58-59) ; on se marie moins pour perpétrer la tradition et honorer les ancêtres « que pour se positionner sur l’échelle sociale, et se procurer le supplément de pouvoir d’achat indispensable pour assumer son statut » (59).
L’amour nihiliste africain est du construit… on aime par intérêt. La romance n’existe pas entre tourtereaux ; Le sexe en Afrique est outil de sélection, d’exclusion, vecteur d’affirmation d’identité (femmes) et d’autorité (homme) ; le sexe devient parfois un instrument d’avancement, on arrange les notes scolaires et académiques par voie sexuelle ; certains professeurs s’adonnent au sexe avec une intrépide volupté… Le chapitre se clôt par les vérités de l’orgasme où l’auteur peut lire l’idéation orgasmique qui conduit certain(e)s africain(e)s à se moquer de la mort. Jouir conduit à la souffrance et en même temps, l’acteur jouissant se moque de la temporalité et de la mort et semble ainsi atteindre par là le nirvana.
Le chapitre 2 « Je mange donc je suis Philosophie de la table » est ouvert par une méditation de Célestin Monga sur une chanson du Groupe Ivoirien Magic System, intitulée « Premier Gaou » ;dans cette musique chantée dans les rues sub-saharienne, l’on découvre Antou ; c’est une jeune femme qui choisit ses amants en fonction de leur pouvoir d’achat ; elle a abandonné son ancien copain au profit d’un fortuné ; ayant constaté que la carrière musicale du Gaou (nigaud dans le jargon d’Abidjan) a pris un envol, elle revient chez lui. Le jeune homme ironise sur les plats de son ancienne copine, en lui promettant du kédjenou (plat épicé composé d’un bouillon chaud en Côte d’Ivoire) d’éléphant ou des plantations d’alloco (frites de banane plantain dans le jargon d’Abidjan) . Ce point de départ anecdotique est un tremplin pour notre auteur qui s’interroge sur le sens du manger en contexte africain. Manger, est-ce un acte innocent ? Manger implique ce qu’on est ou ambitionne d’être. L’auteur réfléchit sur les significations du manger ; à Abidjan ou à Kinshasa, c’est consciemment que l’on choisit ses plats qui sont expressifs de sa condition. On veut manger pour être comme ; je demande un plat de poulet braisé pour manger comme un bourgeois, c’est ainsi que je peux quitter ma classe, le temps d’un repas pour me joindre aux commodités bourgeoises. Monga analyse les diverses formes que peuvent prendre le manger. (90) « Dans les régions du monde où les situations de pénurie alimentaire sont sources d’humiliation quotidienne, ce que l’on mange est souvent un puissant vecteur identitaire et une symbolique du pouvoir. Les Camerounais parlent ainsi de « politique du ventre » pour désigner la perception, dans le subconscient collectif, des stratégies individuelles d’accumulation et de positionnement social, des modes d’accès aux instances de domination – et donc de légitimation de soi. Ce que l’on mange participe donc d’une culture de pouvoir et exprime un éthos de la munificence en même temps qu’un rituel d’appartenance à un réseau relationnel. » (93) ; Manger peut travailler à restaurer l’amour propre et exprime la quête de dignité. Les Grands d’Afrique organisent des mariages, pour se faire voir, se faire valoir et montrer leur puissance ; dans les multiples banquets de mariage ou d’ordination sacerdotale, on voit on voit s’associer à la table d’honneur des évêques, des faymen, des ministres autour des mariés ou des nouveaux ordinands. On mange, on boit du champagne, on écoute Mozart ; Lors de ces mariages, il est très vite attendu le temps des musiques cadencées qui verra honnêtes gens se comporter comme des brigands sur la piste de danse.
Le Chapitre 3, « Poétique du mouvement », est une méditation à partir de la musique. Pour notre auteur, La musique constitue l’esthétique de la vie dans le monde Noir (108) ; la danse comme théorie du mouvement permet de communiquer avec les autres ; néanmoins, il faudrait aller au-delà du superficiel pour juger de la musique africaine et de la danse ; il est possible d’analyser le large éventail stylistique et philosophique des arts musicaux africains (110), que ce soit, lors d’un bal des Camerounais de Toronto, lors de l’écoute d’un Lokua Kanza dont l’album fait éprouver une expérience esthétique ; ou encore à découvrir un Richard Bona est un cinglant démenti anticonformisme et de l’épicurisme souvent allégué contre la musique africaine ou Afro-Américaine. Les Camerounais de Toronto dansent Frotambo (chanson à succès d’une vedette camerounaise Petit Pays) ! Peu importe la condition, femme enceinte ou professeur d’université ; « Pour tous ces braves citoyens qui paient leurs impôts et essaient de respecter les lois, la danse leur permet de déverser non seulement la sueur mais aussi d’exprimer toutes leurs mauvaises pensées, ces désirs inavouables de violence et d’autres choses encore. Elle les libère de la rancune sournoise dissimulée au fond de leur corps. L’espace d’une chanson, elle en fait des hors-la-loi tranquilles, des délinquants en liberté. Le nihilisme est là, bien présent : les « mauvais désirs », les pulsions inavouables, les envies coupables ne sont pas très loin. Peut-être constituent-elles d’ailleurs le secret de la fête. » ; Les danses sont expressives du désir de s’approprier le temps qui passe ;il s’agit d’investir chaque instant dans toute sa vivacité, sa vigueur et son intrépidité; la danse est un désir de se transcender. La danse comme évasion du soi, s’échapper du passé ; éviter le mauvais sort ; célébrer la vie dans la volupté, en dehors des cadres et des carcans ; la danse est une prière païenne. A Toronto, les Camerounais se moquent bien de l’ennui et de l’amertume ; ils cultivent un épicurisme sans concessions le temps d’une fête. La danse se trace la perspective de l’oubli de soi et conforte une éthique de la vacuité. Cependant, la musique n’est pas réductible aux effets de quasi-transe qu’elle produit lors des bals africains qui commencent souvent très en retard ; un autre style de musique et d’une autre qualité peut s’écouter et procurer des émotions esthétiques. La musique de Lokua Kanza, musique de la mélancolie, musique de l’ivresse du désir, musique de la foi, qui donne parfois envie d’aller visiter l’au-delà. Sans bruit ni fureur, elle invalide le misérabilisme et le dénuement dont on affuble trop souvent l’Afrique. Elle dit délicatement sa noblesse et sa dignité dans des arpèges secs, qui égrènent les notes ; chez lui, la musique libère, exalte ; elle est sensuelle et élégante.
Dans la même veine, Richard Bona représente « un compositeur qui veut laisser ses marques à la postérité » ; pour cela, il « doit demeurer maître de ses émotions et de son imaginaire. Il doit viser la précision du chaos »(130) ; tel est l’exercice auquel il se soumet. Sa musique est anti-nihiliste ; elle est « objet de spéculation philosophique et lieu d’exploration des mystères de l’âme »(131). Bona a une musique dont le langage dense et audacieux, rame à contre courant de ces musiques de danse dans lesquelles on voudrait enfermer les Africains. L’autre part d’Afrique sub-saharienne qui danse pourtant dans les liturgies romaines blâme-t-elle les pensées pieuses de Monga qui croit à sa façon ? Avec la manière d’une éthique du provisoire…
Le Chapitre 4 « La saveur du péché. Dialogue autour des funérailles de Dieu » revient sur l’interview accordée au Rédacteur en chef de L’Effort Camerounais de passage à Washington. L’interview n’a pas été publiée dans les Colonnes du journal catholique ; l’interviewer, un abbé assez courageux à l’endroit de sa hiérarchie, a publié le texte dans un autre journal ; rien dans le texte n’indique le nom dudit journal ni son directeur de publication ; néanmoins, l’abbé courageux a reçu les coups de crosse du Nonce Apostolique qui crie à l’hérésie mieux, au sacrilège de Monga. Pourquoi ? L’interview prend des libertés de penser d’avec le donné révélé et d’avec les intendants des choses sacrées lues par la tradition judéo-chrétiennes. Célestin Monga, dans ses démolitions des vérités bibliques et de foi a provoqué l’ire de la nonciature. « Je suis croyant », affirme-t-il ; le Dieu auquel il croit se révèle dans le sourire de ses enfantset dans le courage héroïque des gens simples et ordinaires qui persévèrent et ne se laissent pas décourager par les difficultés de l’existence. La foi étant une affaire personnelle, le débat sur l’existence de Dieu semble bien dérisoire. ; débat infini et sans issue. Dommage que Dieu se laisse manipuler par les idéologies ; Mais il est si tolérant qu’il laisse libre l’athée et ne lui fermera pas les portes du Paradis. Qui décidera si les milliers de chinois qui ne connaissent pas Jésus Christ iront en enfer ?
Que penser du bilan des Eglises Africaines si elles sont conservatistes d’un ordre social et culturel ; l’Eglise comme Institution et ses failles a-t-elle le monopole de la vertu ? En contexte africain, elle ne fait pas montre d’un engagement très prononcé contre le refus de l’inacceptable ; ses princes et pasteurs ne s’engagent pas pour défendre le citoyen ; dès que se présente le danger, ils rentrent dans leurs soutanes ; certes, il y en a qui ont payé de leur vie; mais jusque là, le Vatican ne se bouscule pas pour que lumière soit faite. « Au lieu de passer leur temps à débattre des significations de tel verset de la Bible, les administrateurs des religions révélées pourraient faire le travail de Dieu sur la terre, c'est-à-dire aider les gens concrètement à améliorer les conditions de leurs vies. Concrètement, cela signifierait par exemple qu’ils doivent être fermes dans la dénonciation des autoritarismes africains, ou même simplement qu’ils affichent un engagement plus vigoureux dans la résolution des problèmes de la vie quotidienne, des accidents de la circulation qui déciment les populations et font douter de l’existence de Dieu, à la destruction de l’écosystème qui cause d’énormes dégâts environnementaux à travers le continent »153-154 ; pourquoi ne met-on pas la force spirituelle que contient les Ecritures au service du changement social ? Pourquoi le Vatican n’exige pas que justice soit rendue aux mystérieux assassinats des religieux ?
La prolifération du divin n’est elle pas la conséquence de l’incapacité pour les Eglises officielles de proposer des solutions dans le marché de la demande spirituelle en Afrique ? Les Eglises instituées offrent-elles des alternatives, des rêves aux populations prises aux pièges de la fatalité et de misère ? Encore faudrait-il contester toutes les fratries qui tiennent en laisse les gouvernants au nom d’un mysticisme trompeur et dangereux. Présidents, ministres et autres sont tous logés à l’enseigne de la précarité due à la conscience tourmentée de l’appât du gain ou de la légitimité mal acquise.
Pourquoi la croyance en la sorcellerie fleurit-elle en contexte de pauvreté ? N’est ce même pas contradictoire de penser avoir un Dieu Tout puissant et avoir peur d’un prétendu sorcier ? La croyance au Paradis n’est pas monnayable par rapport au bien ou au mal évité.
Dans le chapitre 5 intitulé « Ethique des usages du corps. Une théorie de l’amour propre », nous lisons une philosophie du corps. Le corps est utilisé en Afrique dans une perspective qui permet de réaffirmer la dignité du pour-soi ; l’érigeant ainsi en instrument d’une vision nihiliste de l’existence. Philosophies du corps perçu, du corps méprisé, du corps revalorisé pour l’auto-estime et le retour de l’amour propre ; pour certains par contre, le corps devient comme une valeur mercantile ; d’autres veulent se pérenniser par l’entremise de changements d’organes… le mercantilisme du corps va jusqu’à accepter pour une africaine à aller se prostituer onéreusement dans les capitales européennes ; affirmant, « c’est mon corps ! » ces femmes se contentent de vivre sans préoccupations métaphysiques, ni valeurs préétablies… Je suis mon corps et je l’emploie en fonction de ce que j’ambitionne d’être ; le corps est source de valorisation de soi et construction d’une identité plus que narrative.
L’auteur, par action citoyenne et continuation de vérification de sa capacité d’indignation s’est rendu au poste de Police du Port de Douala (Chapitre 6 La violence comme éthique du mal.); ce, à la sortie de l’incarcération des leaders de l’opposition Camerounaise, victimes d’avoir parcouru les capitales occidentales et ayant annoncé le début de la fin du biyaisme. A la réclamation de la conférence Nationale Souveraine, fût répondue, une « fessée nationale souveraine » faite de 200 coups assénés aux leaders de l’opposition y compris Samuel Eboua qui en ce temps comptait 67 ans. Ce quasi septuagénaire a été rossé sans indignation par des tortionnaires, sans doute drogués, qui en récompense ont certainement reçu des avancées de salaires. L’ami cynique de Célestin Monga expliquait les ressorts d’une longue vie dans le Cameroun de la violence, par le fait de « comprendre et d’accepter que tout était illusion, et de ne surtout pas tenter d’intellectualiser les petits mystères de la vie quotidienne… » Perspective nihiliste ? Pour revenir à la violence, la bastonnade s’apparente à une pornographie du pouvoir ; c’est un moyen d’intimidation et de dissuasion ; c’est un moyen de laver l’affront ; cette justice affirme la puissance du Président qui, exposant le postérieur de ses adversaires politiques les rendaient derechef ridicule l’opposition par un discrédit et l’affirmation qu’il n’y a qu’un seul Père de la Nation;( 217)
Marquer les corps de violence est l’instrumentalisation de la force démesurée du potentat postcolonial ; dans cette perspective, se situe Prince Johnson qui se délecte de la souffrance qu’il impose à son adversaire politique Samuel Doe. La violence en politique est employée lors des conflits ; par le viol, il s’agit d’humilier psychologiquement, fut-ce les enfants et les femmes. La guerre ne se gagne pas seulement sur le plan militaire, mais sur la capacité de violer l’intimité des femmes des adversaires, imposer sa puissance nue. Les leaders Prince Johnson et Foday Sankoh intègrent deux visions de la violence, « celle de Platon qui voyait dans toute personne un être tyrannique jouissant sadiquement et cruellement parce qu’elle domine les autres afin de se prouver sa propre supériorité ; et celle de Sigmund Freud qui, appréhendait la violence comme une faiblesse de la nature humaine relevant d’un symptôme névrotique »( 226) La violence armée peut-elle être employée lorsqu’on veut libérer les populations contre un régime autocrate et fascisant ? La violence n’est ce pas le lieu de rappel d’une précarité éventuelle ?
Le livre se conclut par une narration-méditation autour des évènements de la mort accidentelle du Père de l’auteur ; il nous suffit de vivre avec la certitude de devoir quitter ce monde un jour ; en fait, la mort de l’autre est comme rappel de ma propre mort. La conclusion nous présente des perceptions nihilistes de la mort et des funérailles (256#1) : comment les vieux des sociétés secrètes des Bana comprennent-elles la mort ? Les danses, lors des funérailles sont pour ces oncles del’auteur un superbe mépris de l’usure de la vie et de l’inéluctabilité de la fin ; mourir pour vivre…
Qu’est ce que le nihilisme en certains modes de vie africains ? Il s’agit, à partir de faits de vie de dégager des visions et des conceptions de la vie ; celles-ci sont portées par le questionnement sur la finitude, sur la manière d’entrevoir la joie comme ouverture à l’être ou au rien ; le nihiliste est celui qui se construit le sens de sa vie en pensant déjà à sa mort ; il vit sans souci d’interrogations métaphysiques ; il existe dans le vouloir-vivre ; celui-ci prend les formes de la femme qui ravale la romance comme expression de l’amour et s’intéresse à sa propre condition qu’elle veut améliorer ; l’on ne se marie plus par amour mais par souci de positionnement social ; l’on mange pour se faire valoir ; l’on aime pour se moquer de la mort et affirmer l’intrusion dans le Nirvana ; quand un alcoolique vient à dire, « tu bois odontol (boisson alcoolique très forte-sorte d’Africa-Gin), tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs ! » et qu’il accepte de se défaire progressivement de sa vie, n’est ce pas du suicide ou alors, vivre dangereusement ? L’épicurisme des goujats n’en est pas loin ; celui qui, pour survivre en postcolonie affirme que tout est illusion, y compris la bastonnade des leaders de l’opposition fait montre d’un cynisme et d’un nihilisme sérieux ; cet ouvrage nous donne les variations du nihilisme : le nihilisme en amour ; le nihilisme dans les conceptions de Dieu ; le nihilisme dans l’usage du corps ; le nihilisme dans la résignation présomptive : « on va faire comment ? Ca va aller ! » L’auteur fonde-t-il son nihilisme dans une réappropriation africaine du pour-soi, de sa dignité et de sa destinée ? Il est question d’être, d’exister par soi ; donner de l’épaisseur à sa vie ; se réapproprier son identité volée ! L’on existe dans l’éphémère, dans le fugace, tout fuit à une allure vertigineuse. Et en dépit de tout, il faut sans doute s’arrêter, méditer et continuer de marquer le temps qui passe par une poétique de la vie que fixe l’œuvre d’art qui chante la beauté. Le texte aurait eu moins de prétention à penser le nihilisme africain s’il se serait mis en perspective de comparaisons d’avec d’autres formes de pensées de la finitude sous d’autres sphères culturelles. Vivre autrement sa Négritude en dehors des cadres officiels et l’inventer au quotidien est possible. Comme toujours, il revient de ne pas absolutiser son propre point de vue et se remettre sans cesse en question pour davantage de responsabilité vis-à-vis du monde qui nous est donné à la naissance.
Akono François-Xavier.
CELESTIN MONGA. Nihilisme et négritude. Les arts de vivre en Afrique, (Paris: PUF, 2009) 263 p.
Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance d'Emmanuel Renault
Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance d’Emmanuel Renault est porté par des questions sociales. Les thèmes de la reconnaissance et du mépris sont examinés à partir des questions directrices suivantes, traitées en quatre chapitres : Qu’est-ce que la reconnaissance ? Qu’est-ce que le déni de reconnaissance ? Qu’est-ce que le mépris ? Ne faudrait-il pas faire le diagnostic et dénoncer deux formes de « mépris social » (p. 17), à savoir, « le déni de reconnaissance qui consiste en une négation de la dignité » (p. 17) ce qui est l’objet du chapitre 2) ; et « le déni de reconnaissance qui consiste en une négation de l’identité » (p.17 ; objet des chapitres 2 et 4).
Le chapitre 1 relit l’histoire de la philosophie en vue de dégager le lien entre politique et morale. L’auteur interroge Karl Marx, Kant et Hegel. Axel Honneth est largement commenté dans son ouvrage thématique sur le thème de la reconnaissance.
Pour Marx, la conflictualité constitue la nature du politique ; sa nature n’est donc pas le bien commun. La politique ne se réduit pas au domaine institutionnel. Elle s’ouvre aussi dans les lieux où l’exploitation sévit. Il revient surtout d’interroger les sphères où la domination est vécue. La morale peut être au service de l’idéologie de domination, d’où l’intérêt à la questionner. Marx a également questionné « l’hypocrisie morale » (p. 25), « celle qui demande aux plus démunis d’agir d’après le mode de vie des dominants » (p. 25). Le sujet prétend être moral tout en demandant à celui qui souffre de se dé-merder. Renault évalue de manière critique la théorie de Marx. Pour lui, elle est certes pertinente du point de vue critique, mais « elle ne suffit plus pour la construction politique d’une alternative » (p. 27). Les luttes des classes sont-elles réellement portées par « une perspective émancipatrice » (p. 27.)?
Kant soutient que la politique doit trouver son principe dans la morale. Cette perspective n’est pas acceptée par Hegel. La politique va plus loin qu’une simple application des normes morales. Pour Hegel, « La véritable valeur morale se trouve dans la concrétisation des normes morales par l’action, en effet, les normes morales ne valent pas pour elles-mêmes, mais seulement pour leur concrétisation pratique» (p. 33) En fait, « la morale doit définir les conditions qui permettent à un individu de donner le plus de valeur possible à son existence. Or, notre existence n’a véritablement de valeur que si nous parvenons à vivre en fonction des règles que nous nous donnons à nous-mêmes, que si nous parvenons à l’autonomie et à l’autodétermination, c’est-à-dire à la liberté véritable » (p. 33). D’après Hegel, « c’est seulement dans l’Etat que l’individu peut accéder à cette autonomie véritable, car c’est seulement en tant que citoyen qu’il peut contrôler les conditions sociales de son existence, prendre conscience de la valeur sociale de ses différentes activités et accéder à la compréhension du sens de sa vie » (p. 34).
Une question essentielle est soulevée dans cet opuscule :
« Que faire quand les conditions sociales d’une vie décente ne sont pas remplies ? Ne faut-il pas repartir de principes moraux pour élaborer une critique intransigeante de l’ordre existant ? N’est-ce pas la morale et elle seule qui permet de dénoncer les situations rendant une vie bonne impossible? » (p. 34.)
Le chapitre 2 commence par une énonciation des conditions de l’action morale qui impliquent le sujet. Cette action obéit à trois facteurs : (1) l’estime de soi ; le sujet est en mesure de penser que son action « dépend de lui »(2) ; et qu’en (3) « elle, doit se lire sa propre valeur » (p. 37). Ces conditions qui sont axées sur l’autonomie n’impliquent-elles pas une dimension sociale ? Il y a un lien entre « le rapport positif à soi » (p. 39) et la reconnaissance. A partir de ce rapport s’enracine la possibilité de comprendre les injustices qui touchent douloureusement l’identité du sujet. « Le point essentiel est que le rapport positif à soi est intersubjectivement constitué, et de ce fait, qu’il est intersubjectivement vulnérable » (p. 41).
La méconnaissance et le « déni de reconnaissance » (p. 41) affectent durement le sujet dans ses rapports avec autrui. « "Si les jeunes de banlieues "exigent si souvent le respect , s’ils posent aujourd’hui la question de la reconnaissance, ce n’est pas par un effet de mode mais parce qu’ils souffrent effectivement d’un déni de reconnaissance, d’un défaut de respect structurel, c’est parce qu’ils souffrent d’un mépris qui n’est pas seulement individuel, mais qui est bien social et qui s’explique par le fait que la crise sociale ne permet plus aujourd’hui aux institutions, aux lois et aux usages sociaux d’assurer les conditions de la reconnaissance réciproque des individus dans l’interaction » (p. 44)
Les blessures peuvent conduire à la révolte. Le mépris dans sa dimension sociale touche « aux conditions sociales et institutionnelles du déni de reconnaissance » (p. 44). « La révolte qui suit le déni de reconnaissance n’est pas toujours moralement justifiée, mais elle relève néanmoins toujours d’une lutte pour la reconnaissance, et de ce fait, elle possède toujours un noyau normatif. Elle exprime en effet une exigence légitime : celle d’un rétablissement des conditions du rapport positif à soi et d’un minimum d’autonomie » (p. 45). Pour l’auteur, « la reconnaissance ne définit pas seulement le contenu normatif des révoltes urbaines : elle définit les normes des luttes sociales et politiques en général »(p. 45). La révolte est souvent due au fait que certains s’estiment lésés et qu’ils ont l’impression de subir des formes de domination. La protestation vient de ce qu’un sentiment d’injustice soit réellement éprouvé.
Le chapitre 3 s’intitule « morale et politique de l’identité » ; il commence par une réflexion sur la pensée de Habermas. Emmanuel Renault va plus que lui, en fondant l’éthique de la reconnaissance, non pas au niveau d’une communauté langagière qui s’entend sur les normes mais sur l’intersubjectivité vécue dans des rapports humanisés.
« Les présuppositions de l’éthique de la reconnaissance sont anthropologiques, tout comme ses objectifs : la construction d’une anthropologie de la morale et de la politique. Son objet spécifique est le rapport positif des individus à eux-mêmes qui, sous sa forme concrète, est le rapport qu’ils entretiennent avec leur propre identité » (p. 76). L’auteur invite à penser une double direction de l’éthique de la reconnaissance : « construire une morale de l’identité et à rapporter la politique aux questions d’identité »(p. 76). « Le déni de reconnaissance » (p. 77), c’est refuser de reconnaître sa dignité à une personne. Désirer être reconnu dans sa dignité revient aussi à vouloir être reconnu dans son identité. La personne qui vit dans un univers social est-elle portée par son identité ; et si elle n’a donc pas de rôle social, n’existera-t-elle pas ?
Quelle est la perception qu’a l’auteur de l’identité ? « Qu’est-ce qu’en effet l’identité personnelle, sinon l’ensemble des représentations durables de soi-même en quoi consiste la représentation de la valeur de notre propre existence ? Notre identité c’est l’ensemble des caractéristiques qui, pour nous, constituent notre essence, l’ensemble de caractéristiques dont nous croyons qu’elles nous engagent pour notre vie entière ou pour une durée non négligeable de celle-ci, et qu’elles font la valeur de notre vie. C’est dans notre identité que, pour nous, se joue la valeur de notre vie, et celle qu’il nous faut faire reconnaître si l’on veut faire reconnaître notre valeur » (p. 78). Pour Emmanuel Renault, l’identité renvoie à la reconnaissance. (p. 78) dans un rapport intersubjectif entre moi et autrui. Pour lui, il s’agit pour le sujet de « faire reconnaître les différentes identités » dans ses facettes multiples ont un rapport harmonieux. (p. 84). Un licenciement perturbe par exemple la personne dans son vécu social mais il l’atteint dans son identité personnelle.
Le chapitre 4 précise une compréhension du mépris social. Il « peut prendre deux grandes formes (qui relèvent elles aussi de types idéaux admettant toute sortes de combinaisons : celle de la domination culturelle, qui toujours s’impose une image dépréciée de soi-même, et celle que nous nommerons la fragilisation de l’identité, c’est-à-dire de la tendance interdisant aux individus de voir confirmée leur identité » (p. 117.) La domination culturelle (p. 117) s’expérimente par exemple dans le colonialisme. C’est le fait d’imposer ses manières de voir et de faire à d’autres groupes qui ont les leurs ; et chez qui, à terme, l’on produit une « image dépréciée » (p. 117) de ses membres, chez qui le dominant veut faire acquérir des sentiments d’infériorité. L’on pourrait aussi s’interroger sur ce qui pourrait fragiliser l’identité personnelle dans un contexte de diversité.
Le livre est intéressant car il permet de penser les questions difficiles de la discrimination raciale, la souffrance pour cause de mépris identitaire. Les immigrés peuvent-ils voter ? Qu’en est-il des sans-papiers exploités par les sociétés occidentales ?
François-Xavier Akono.
Références du livre:
-Emmanuel Renault, Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance, Éditions du Passant, 2004
La Tragédie du Pouvoir. Une Psychanalyse du Slogan Politique -de Charles Zacharie Bowao
Ces trois dernières années, Charles Zacharie Bowao, philosophe congolais a publié trois essais autour de l’éthique en politique, de l’imposture de l’ethnocentrisme dans l’univers politique congolais et africain, et du plaidoyer sur la question du changement de la Loi fondamentale au Congo-Brazzaville. Considérer ces textes, c’est comprendre l’importance que le philosophe Bowao accorde à l’évolution des institutions, à l’alternance démocratique et à la place de l’éthique en politique. Le titre de l’ouvrage soumis à notre analyse illustre très bien cette volonté qu’a l’auteur d’apporter une lumière sur les questionnements démocratiques aujourd’hui victimes de la barbarie tyrannique des chefs d’État assoiffés de pouvoir et matérialisés par les soi-disant parti fondateurs.
Écrit dans le contexte précis de la brûlante question du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 en République du Congo, La tragédie du pouvoir. Une Psychanalyse du Slogan Politique, tout en ciblant la dite question est un plaidoyer pertinent pour les politiques africaines qui se ressemblent tant dans la mal gouvernance que dans la pratique des méthodes violentes et exclusives dans leur gestion de la cité. Sans nous limiter à la dimension congolaise, nous nous focaliserons également sur la dimension plus universelle du livre. Ainsi donc la question globale posée est celle de « nos institutions, de leur valeur, du respect que nous avons pour elles et de ce qu’on appelle ordinairement l’état de droit » (Bowao, 5). Les questions que soulèvent les cinq chapitres de ce livre concernent tous les pays d’Afrique. D’ailleurs, l’auteur n’hésite pas à prendre l’exemple du Niger et du Burkina Faso pour illustrer ses prises de position.
Rétrospection, Introspection et prospection
Charles Zacharie Bowao part de la conférence nationale souveraine pour permettre de comprendre ce qu’il appelle le « vrai faux problème de la constitution du 20 janvier 2002 ».
Tout d’abord, il montre que le « plus jamais ça » devenu désormais slogan vide a tourné le dos à ceux qui l’ont invité sur la scène politique congolaise. Ensuite, il souligne que l’idée de changer la Constitution a engendré diverses attitudes au sein de la classe politique congolaise : déchainement des passions, circulation de l’argent et son corolaire la corruption des esprits, la manipulation des consciences, le fanatisme militant embrigadant les médias d’État. L’auteur dénonce aussi l’ethnocentrisme qui guide les hommes politiques qui se considèrent comme les sauveurs de la république. C’est le règne de la tragédie, parce que la politique veut sacrifier l’éthique, comme il l’écrit: « La politique est tragique lorsqu’elle se joue sans fondement politique. Lorsque le plaisir du pouvoir va au-delà du raisonnable, il devient pathologique. De ce plaisir pathologique du pouvoir au déplaisir tragique d’une société, il n’y a qu’un pas que l’on appelle couramment le saut dans l’inconnu » (Bowao, 31). En fin de compte lorsque le déraisonnable emboîte le pas au raisonnable, c’est la naissance de la tragédie.
On retrouve dans le livre les différentes questions qui se posent aux pays africains en voie de démocratisation : la Constitution, la manipulation de la population, la durée des mandats, la limite d’âge, la répression, la haine de l’alternance démocratique. C’est le cas du Congo, du Tchad, du Cameroun, du Gabon, le Togo, le Burkina Faso de Compaoré, la RCA de Djotodja où la dérive ethnocentriste, égocentrique et clanique ont pris les couleurs des parades nationales, mêlant hypocrisie, haine, jalousie et mauvaise foi considérés désormais comme critères de la politique ethnocentriste. Bref, l’auteur évoque la situation qui prévaut dans la plupart des pays d’Afrique où le pouvoir est mystifié et tend à se « monarchiser » en vue d’excuser toutes les dérives et les folies des gouvernants. L’auteur estime aussi que les problèmes que soulèvent les tyrans des pays africains conduisent inéluctablement à la tragédie républicaine. D’où la dénonciation, dans le cadre du Congo par exemple, que l’échec de la démocratie ne se perpétue dans le pays, car comment comprendre qu’après la victoire face au monopartisme, le Congo redevienne encore aujourd’hui un état totalitaire et monolithique ?
Au niveau de l’introspection, la solution pour l’auteur est évidente: l’éthique, la responsabilité, l’alternance démocratique et l’amour du bien commun se matérialisant par une conversion des mœurs et du regard sur notre société.
Dans la dimension prospective du livre, Charles Zacharie Bowao estime qu’il « n’existe pas de démocratie à l’africaine ou à la congolaise, encore moins substantiellement de constitutionalisme de semblable nature. En ses principes fondateurs, ou en ses normes pratiques, la démocratie est universelle. La science juridique ne l’est pas moins. Dans ce sens, nul ne devrait avoir peur de l’alternance démocratique. Celle-ci participe de la respiration normale d’un pays. C’est cela le bon sens démocratique, qui n’a strictement rien de comparable avec une quelconque légende des termitières ». (Bowao, 64-65)
À l’embranchement de la philosophie politique, de la Logique, du droit, le livre de Charles Zacharie Bowao interpelle par une dimension pratique constante des questions qu’il soulève. Ce qui montre à juste titre que le philosophe n’est pas seulement celui-là qui, marchant avec une bougie le jour, contemple des étoiles inexistantes dans la clarté du jour. Bien au contraire, le philosophe congolais démontre que le philosophe est celui-là même qui se préoccupant des questions de son temps et de son milieu de vie, sait aussi s'engager pour faire bouger les choses.
La mission de l’intellectuel
Le temps des indépendances a été celui d’une naissance, naissance des élites africaines. Mais que sont devenues aujourd’hui ces intellectuels d’il y a cinquante ans, ou encore, puisque l’on parle d’une renaissance Africaine, quel pourrait l’impact des intellectuels africains, ou quels pourraient être l’impact des intellectuels africains? Si aujourd’hui, les sociétés demeurent conscientes qu’on ne peut se passer de cette conscience intellectuelle, il reste que plusieurs intellectuels africains, qui non seulement d’avoir voulu faire de son intellectualité un métier, ont abdiqués et se sont laissés happer par le populisme politique en sacrifiant ce qu’ils avaient de plus cher : le savoir et l’humanité. En intégrant les intellectuels dans leur politiques, les pouvoirs politiques ont aidé ces derniers à devenir des hommes machines et bavards dont le maraudage intellectuel est devenu la norme. Aujourd’hui la stagnation de la politique africaine peut désormais être imputée à ces Universitaires devenus des penseurs pirates car ils sont entrés dans le sillage du brigandage de la connaissance, de la mêmeté et de la répétition.
Charles Zacharie Bowao n’hésite pas, dans son livre, à faire référence de l’ouvrage de Julien Benda, La trahison des clercs, pour montrer combien les intellectuels congolais et africains sacrifient les valeurs universelles pour des intérêts égoïstes. Chacun semble vouloir à tout prix plaire au Président de la République, et là tous les moyens sont bien pour fossoyer non seulement la science, mais aussi la démocratie et les autres. C’est pourquoi assumant sa mission d’Intellectuel-philosophe, il invite ses concitoyens, à faire montre de leur courage et de leur engagement pour dénoncer tous les maux qui minent la société ; car si en Afrique les intellectuels ont créé une sorte de pacte de destruction lente et massive avec les pouvoirs en place, il n’est jamais trop tard pour eux de revenir à leur vocation première qui consiste, comme l’écrit Malolo Dissaké, « à mettre en mouvement une pensée critique libre et responsable, qui pratique ordinairement la subversion éthique, y compris et surtout en politique, et qui a pour seule gouverne la poursuite de la vérité en toute indépendance d’esprit » (Bowao, 16)
En quoi ce livre parle-t-il à l’Afrique aujourd’hui ?
Charles Zacharie Bowao est fils de son temps et philosophe de son époque. Il le montre en soulevant des questions pertinentes qui touchent la vie politique dans son actualité la plus contemporaine. La question de l’intégration démocratique africaine est une question présente dans tous les esprits, parce qu’elle demeure la condition importante pour que le Continent s’embarque dans l’Universel. Qu’il s’agisse de la démocratie, du pouvoir, de la gouvernance, de l’éducation, du développement, la plume de Charles Zacharie Bowao répond toujours « présente ».
Tout compte fait, il est donc temps que les pays africains tournent la page noire des changements politiques désastreux et illégaux matérialisés par les coups d’État, les tricheries massives lors des élections et des hold-up constitutionnels, la gangrène de l’ethnocentrisme qui est une « dénaturation historique, qui entrave la volonté populaire exprimée et reconnue de temps à autre. » (Bowao, 36). Sans cela, il nous sera difficile de faire partie de la grande famille des nations politiquement stables où ce ne sont pas les chefs d’État qui sont forts mais les institutions. Le vivre-ensemble en dépend. Pour des intérêts personnels et égoïstes, les dictateurs doivent-ils s’auto-prescrire une descente progressive aux enfers et imposer la misère à leur population ?
Pénélope Mavoungou
Ouvrage:
Charles Zacharie Bowao, La Tragédie du Pouvoir. Une Psychanalyse du Slogan Politique, Paris, Éditions Dianoïa, 2015, 72p. ISBN:978-2-37369-007-1